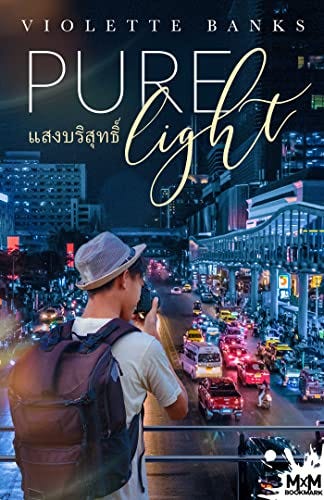Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.
La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.
J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !).
Il y a quelques jours, je notais dans mon journal :
“Au sujet de la newsletter : (…) Il est peut-être temps que je retourne à mon exploration de l’homoromance et de la production LGBTQ+. J’ai envie de partager le fruit de mes lectures, répondre à des questions (même les plus absurdes ou les plus incongrues) que mes lecteurices pourraient avoir, présenter quelques œuvres ou faire découvrir des artistes-créateurices.”
Du coup :
Et allons plus loin : pourquoi ne pas m’envoyer les questions que tu te poses sur l’homoromance et le reste ? J’y répondrai le plus sérieusement possible (ou pas !).
So long!
Enzo
Samedi 1 juillet
Dans Pure Light, Violette Banks montre comment une autrice française peut écrire un roman qui se passe à Bangkok avec des personnages autochtones ou britanniques sans que ça fasse carton-pâte. Elle est donc le contre-exemple de ce que je disais hier.
À mon avis, elle y arrive parce que son style n’est pas descriptif : peu importe où se passe la scène (que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie), elle nous donne peu d’indices sur le lieu (les bruits, les odeurs, les températures et l’humidité). Elle insère aussi peu de mots thaï, mais indique clairement comment les honorifiques fonctionnent (p' et nong, etc.) et donnent des exemples précis de la vie quotidienne (comment commander un taxi, ce qu’il faut éviter de faire dans le métro, etc.), ce qui suffit à nous faire sentir que nous sommes à Bangkok et que l’autrice a fait les recherches nécessaires (assez pour faire croire qu’elle s’y est déjà rendue, même si ce n’est pas le cas).
J’ai beaucoup aimé le portrait qu’elle dresse de l’industrie du BL thaïlandais, car il était documenté, précis et juste… Elle laisse deviner ses zones d’ombres sans pour autant les discuter (un choix que je respecte).
Enfin, je ne crois pas avoir lu de romances aussi slow-burn que Pure Light. Ça mijote si lentement que l’amour pourrait se faire passer pour de l’amitié. Les personnages principaux ne prennent conscience de leurs sentiments qu’à la fin, quand il est presque trop tard. L’absence de cul (ou presque) et de tension sexuelle a rendu la lecture agréable ; dans le genre hypersexualisé du M/M, ce type de choix est reposant.
Lundi 3 juillet
Pourquoi partageons-nous notre quotidien, nos pensées, avec des étrangers sur les réseaux sociaux ? Quel(s) besoin(s), exactement, satisfaisons-nous ? Celui de tenir une cour ? Celui d’être rassuré·e ? Celui d’avoir de l’influence ? De faire du bruit, d’occuper la place ou de laisser une trace derrière soi ?
J’aimerais croire que c’est pour le partage… mais le vrai partage n’existe pas sans une écoute sincère. Il est impossible quand on souhaite dominer un débat ou avoir raison à tout prix. Ce n’est pas non plus du partage si on impose aux autres des faits, des opinions, des avis qu’iels n’ont pas demandé.
Lundi 05 juin
Le format court des séries japonaises est celui que je préfère. Je n’aime pas les séries à rallonge, en particulier chinoises, qui se développent sans forme et, semble-t-il, sans fin. Leur pouls est mou ; mon intérêt se fane assez vite. J’ai besoin d’une tension et d’une direction : ce qui m’intéresse, c’est la progression de l’intrigue, même dans les romances. Je veux des enjeux.
Si j’en crois mes préférences, la Goldilocks zone des séries asiatiques se situe entre 10 et 14 épisodes : en deçà, on aimerait passer davantage de temps avec les personnages (surtout si le concept ou l’histoire sont originaux) ; au-delà, il y a de fortes chances que certains épisodes ne servent à rien.
Le format coréen de 16 épisodes (d’une heure et des poussières chacun) est un peu longuet, même quand on les regarde en accéléré. Les plus insupportables sont ces séries romantiques si lentes qu’on finirait par s’endormir devant l’écran. (La dernière que j’ai regardée : Call It Love avec Lee Sung Kyung et Kim Young Kwang.)
Dimanche 9 juillet
Pour être heureux, il faut se méfier de son instinct, de cette petite voix qui nous murmure que l’on vivrait mieux (ou tout aussi bien) sans la compagnie d’autrui.
Quand on ne veut voir personne, il y a de fortes chances que ce dont on a besoin soit l’inverse (de la compagnie, oui, mais peut-être pas la compagnie habituelle qui a vidé nos batteries).
Nous sommes des créatures sociales. Nous avons toustes besoin de chaleur humaine.
*
Rien ne remplace une bonne discussion (de visu ou au téléphone) avec un·e ami·e.
Quand je discute avec Stéphane, pendant quelques heures, je me sens plus léger, moins seul (c’est comme si nous redevenions les deux collégiens que nous avons été, sauf que maintenant nous discutons de politique, de nos vies amoureuses et sexuelles, de nos tracas professionnels et de la fin du monde). Ce que nous nous disons n’est pas toujours joyeux, mais mon humeur (et, j’ose espérer, la sienne) est toujours meilleure après.
Mardi 11 juillet
Dans sa Masterclasse, l’écrivain Xavier Mauméjean explique sa manière d’écrire un roman :
« Je ne procède pas par journées, j’ai le sentiment que ma manière de travailler est une manière picturale. Toutes proportions gardées évidemment, je compare ça au travail de Jackson Pollock ; je crée, mettons, deux-cents fichiers et au fil de mes recherches, je diffuse l’information dans les fichiers, mais sans me soucier de l’intrigue, sans me soucier de la narration, et petit à petit, vont se détacher des éléments. Quand les fichiers sont ouverts, c’est visuel. C’est une approche formelle, classique qui fait que je n’écris jamais dans la continuité, j’écris souvent la première phrase et la dernière phrase, mon point de départ et mon point d’arrivée et ensuite, ça dépend de la richesse de la documentation, de l’envie du moment, je peux aussi écrire le chapitre 24 et ensuite, le chapitre 3. Je ne relis pas, je quitte le chapitre et il est écrit. Je ne lisse pratiquement pas. D’ailleurs, j’aime bien dire “Il ne me reste plus qu’à rédiger”, parce que c’est vrai. Pendant des mois, j’ai la représentation visuelle des chapitres et je pioche. Le style lui-même est justifié par le projet, j’essaie de n’avoir jamais le même style selon les romans (…) »
*
Un jour, il faudra que je m’essaye à écrire un roman dans le désordre. Je ne suis pas sûr d’en être capable : j’écris les miens comme je les lirais, dans l’ordre. Quand je suis d’humeur audacieuse, j’intervertis deux chapitres.
Les seuls projets que je me verrais bien composer dans le désordre sont éclatés, des recueils de textes fragmentés où l’histoire est discontinue et partielle. Des potpourris, comme Always Coming Home de Le Guin, où l’unité n’existe que dans la diversité chaotique du texte.
Dans mes carnets, je note ces idées d’ouvrages, mais je ne les écris jamais, peut-être parce que je ne suis pas sûr de la méthode à suivre. J’ai besoin d’ordre pour calmer ma nature anxieuse.
Jeudi 13 juillet
Hier, j’ai découvert l’existence de la psychologie culturelle, qui explore le lien entre psychologie et culture (rien de surprenant vu le nom).
J’ai appris que la manière de penser occidentale était différente de la pensée asiatique… que cette différence n’était pas seulement linguistique (les mots recouvrent différentes réalités), mais qu’elle était structurelle.
La pensée occidentale est analytique tandis que l’approche orientale est holistique : par exemple, en Europe, nous préférons noter les spécificités d’un objet (une table est une surface plane et horizontale qui repose sur quatre pieds ou un piètement central) tandis qu’en Asie, c’est le contexte qui apparait en premier (c’est autour d’une table que les gens d’une même communauté mangent).
Cette différence fondamentale de penser le monde se retrouve dans le design des pages web : l’Occident promeut le minimalisme, où l’on focalise l’attention sur une seule information de crainte de submerger l’utilisateur, tandis que l’Orient aime la densité, car l'utilisatrice est habituée à gérer davantage d'information en même temps.
Pareillement, on retrouve cette différence dans les émissions de divertissement : en Asie, l’écran est surchargé d’animations, de citations et de commentaires… Il se passe tellement de choses que le spectateur occidental ne sait plus ce qu’iel doit regarder. Même His Man, le dating show coréen, qui n’est pas le pire en la matière, cite et résume constamment ce que les participants se disent.
Ce que je trouve fascinant avec ces variations culturelles, c’est qu’elles nous rappellent qu’aucune culture n’a davantage raison que sa voisine : certes, nous sommes dérouté·es par certaines pratiques qui nous semblent aller à l’encontre de la logique (ou du bon gout), mais ça ne veut pas dire que les autres ont tort pour autant. Il n’y a pas une bonne et une mauvaise manière de regarder le monde. C’est une leçon d’humilité qu’il serait bon de propager sur les réseaux sociaux.
Dimanche 16 juillet
Harrogate est située au nord de Leeds, à 1 h 30 de Sheffield en voiture. Cette ville n’est pas sans rappeler la séduisante Bath. Elle a une belle architecture et une taille relativement modeste (env. 70 000 habitants). Pendant des générations, ses eaux pures ont attiré les souffreteux riches et influents… Et une balade dans ses rues ou ses espaces verts prouve que l’argent est encore présent. Harrogate est bourgeoise dans ses gouts comme dans ses manières.
*
Mon rêve, c’est de vivre dans une jolie ville comme celle-ci (la bourgeoisie m’insupporte, mais je suis prêt à quelques sacrifices pour une meilleure qualité de vie). Je m’imagine dans une belle maison, spacieuse mais pas pour autant immense. À l’abri des regards si possible.
Comme on n’en trouve aucune à Harrogate qui soit en dessous d’un demi-million de pounds, autant dire que ça n’arrivera pas. Ma carrière ne me permettra jamais ce train de vie. Si j’avais été obsédé par l’argent, j'aurais travaillé dans le secteur bancaire et non dans l'administration universitaire.
*
Il reste, évidemment, la loterie… C’est une sorte de deus ex machina quand on planifie ou rêve sa vie. Je crois sincèrement que j’ai moins de chance d’écrire un bestseller que de gagner le jackpot de l’EuroMillions. De deux scénarios improbables, le second est quand même plus probable que le premier.
Imaginons une seconde un auteur de romances gay, écrites en langue française, qui connait un succès tel qu’il devient aussi riche qu’un gagnant de l’EuroMillions (disons, 17 millions d’euros).
Je répète, car il faut faire un grand effort d'imagination : un auteur français de romances gay. 17 millions d’euros. Allez, comme je me sens d’humeur généreuse, baissons à un million d’euros…
Non, même avec un deal Netflix, signé sur un malentendu, c’est tout bonnement impossible.
Évidemment, si le destin veut me troller à l’échelle cosmique, j’accepte d’être la victime de ce foutage de gueule et de devenir le premier auteur de romances gays français à connaitre un succès similaire à Twilight, Fifty Shades ou HP. En attendant, j'ai acheté mon billet pour le prochain tirage de l'EuroMillions. Il vaut mieux être prudent.
Jeudi 20 juillet
Quand j’étais adolescent, c’était la fiction qui m’importait le plus. Être écrivain, c’était écrire des romans (ou des nouvelles).
Durant ma vingtaine, j’ai prêté attention aux autres genres. Je me suis intéressé à ce que l’on nomme ici la « non-fiction » : les essais, les documentaires, les biographies, les journaux, les blogs, les récits de voyage, les livres de développement personnel, que sais-je encore ?
Maintenant, être écrivain ne veut plus dire être romancier… De toute manière, je lis moins de fiction que de non-fiction, car d’autres médias (séries TV et films) ont pris le relai. J’étanche ma soif de storytelling différemment. C’est tout.
Maintenant, être écrivain, ça veut dire prêter attention aux mots que l’on utilise. C’est être un artisan du verbe. Peu importe ce que l’on écrit, peu importe les genres.
Vendredi 21 juillet
Je trouve intéressant qu’on me rappelle (comme dans la série coréenne, Doctor Cha, disponible sur Netflix) que toutes les histoires n’ont pas besoin d’une romance… et que le personnage principal est en droit de rejeter les avances d’un docteur, extrêmement sexy et bien plus jeune qu’elle.
C’est décevant, certes (il était vraiment sexy et avait tout pour plaire), mais logique : l’épanouissement personnel ne passe pas obligatoirement par le couple.
La romance voudrait nous faire croire qu’elle est le remède à tous les maux, que le célibat est synonyme d'inquiétude, de solitude et de frustration…
L’épanouissement peut, et devrait, se trouver ailleurs. Pourquoi dépendre d’une autre personne pour connaitre son happy end ?
Mardi 25 juillet
Il s’agit d’une fugue. Quand je rêvasse à la belle maison que je pourrais gagner grâce à la loterie, je ne pense pas à ma vie telle qu’elle est maintenant ; je ne réfléchis pas plus à la manière de la changer. J’imagine une situation différente qui ne m’aura demandé aucun effort, ni aucun sacrifice : je me berce d’illusions. Ce que je semble vouloir, ce n’est pas une vie différente ou meilleure, c’est une vie facile.
Vendredi 28 juillet
Le Petit éloge de la poésie me donne des envies d’écrire un éloge de l’homoromance.
Je me demande quelle forme ce texte prendrait, ce que je pourrais écrire au sujet du BL et du MM… Ai-je seulement quelque chose d’intéressant à dire sur toutes ces productions que je consomme au quotidien ?
Je suis d’un naturel critique (je suis français après tout), j’ignore si je peux faire l’éloge sans être tenté de dézinguer mon sujet en même temps. Ōdī et amō, toussa, toussa.
Me connaissant, je serais obligé de nommer mon petit livre « éloge paradoxal de l’homoromance ».
Dimanche 30 juillet
Je deviens de plus en plus allergique à la masturbation intellectuelle. Je ne supporte plus ces textes qui confondent une forme « jolie », voire opaque, avec du contenu profond. En réalité, ils sont creux, ils ne disent rien et ne veulent rien dire. La syntaxe et le vocabulaire endimanchés ne sont pas les marqueurs d’une pensée supérieure ou mieux aboutie. C’est de la poudre aux yeux.
Je viens de terminer ma lecture du Petit éloge de la poésie. Les deux tiers, voire les trois quarts, sont de la branlette. J-P Siméon se fait mousser et fait mousser son sujet, et ce, sans jamais citer un seul poème. Il s’agit d’un essai « hors-sol », un peu comme les tomates qu’on nous vend au supermarché. Ça nourrit mal l’esprit.
Mercredi 02 août
Il y a des gens pour croire que le « fan service » (où deux acteurs prétendent sortir ensemble), c’est la vérité vraie, et non une transaction commerciale où le fan paie pour voir les acteurs se câliner en direct. Rien n’est vrai dans le « fan service », ou, du moins, tout est exagéré…
Le fan service, qui brouille les cartes entre réalité et fantasme, ne saurait, pour autant, servir d’excuse au harcèlement que ces acteurs subissent de manière régulière. Ils ont droit à leur vie privée, ils ont droit d’avoir un petit-ami ou une petite-amie, ils ont droit de garder cette partie-là… eh bien… privée. Ils n’ont de compte à rendre à personne ; aucune excuse à présenter à quiconque.
Le fan service n’est pas un esclavage ; les fans ne possèdent pas leurs stars. Les dérives que l’on voit dans le milieu du BL/GL thaïlandais, par exemple, sont choquantes… Et je ne crois pas qu’on puisse balayer de la main ces comportements en affirmant que les acteurices, jouant avec le feu, savent dans quoi iels s’engagent. Rien ne justifiera jamais que l’on viole l’intimité de quelqu’un pour satisfaire les désirs égoïstes de la populace.
Jeudi 03 août
L'ennemi de l'écrivain·e, c'est la vie quotidienne, celle qui nous détourne de nos préoccupations artistiques (petites comme grandes). Boulot, famille, tracas, tout est bon pour voler notre temps et notre énergie si bien qu'il ne nous en reste peu ou plus à consacrer à ce qui nous importe.
Mais c'est cette même vie quotidienne qui sert de terreau à notre imaginaire et sans laquelle nos écrits seraient pauvres et inintéressants. Pour bien écrire, il faut donc vivre pleinement, même si on court le risque de n'avoir plus le temps d'écrire...
Samedi 05 août
En Occident, on voit beaucoup d’histoires d’amour sur le petit écran, mais le genre de la romance est, finalement, assez peu présent dans les séries TV. L’amour est un condiment que le retrouve partout, la sauce qu’on utilise pour relever n’importe quelle histoire, mais rarement le plat principal (c’est-à-dire la préoccupation principale de la série).
La romance a colonisé les films (surtout au moment de Noël), mais pas vraiment les séries TV.
XO, Kitty et Heartstopper sont deux exceptions notables qui semblent confirmer la règle : la première, qui se passe en Corée, a pour modèle évident toute la production romantique coréenne ; la seconde surfe sur la vague du BL asiatique en proposant son équivalent occidental.
Car s’il y a bien une grande différence entre l’Occident et l’Asie, c’est que cette dernière n’a pas honte de produire de la romance, de la vraie, de la dégoulinante. La Corée du Sud en a fait son beurre… la hallyu ne se limitant pas à la K-pop et à BTS.
Dimanche 06 août
Hier soir, Stéphane m’a demandé pourquoi nous n’avions pas de BL sur nos petits écrans occidentaux. (Heartstopper étant encore l’exception qui semble confirmer la règle.)
La communauté internationale du BL est la preuve que le public est présent même dans notre partie du monde. Le succès littéraire de la romance M/M aux États-Unis et en Europe n’est plus à prouver. Ça doit donc être commercialement viable de produire du BL sous nos tropiques…
Je m’explique ce phénomène ainsi :
Malgré son succès commercial, la romance est encore mal vue ; et le BL est un sous-genre de la romance, un genre encore perçu comme étant féminin. Des histoires d’hommes qui aiment des hommes pour un public de femmes : c'est une combo qui n’intéresse pas les mecs cis-hét qui commissionnent les séries TV. Voyons là des relents de misogynie et d’homophobie.
Il existe deux manières de traiter une histoire d’amour entre hommes : une manière réaliste (on parle alors de production LGBTQ+) ou une manière idéalisée (avec son Happy Ever After, c’est ce que l’on nomme le BL). En Occident, nous avons toute une tradition de films LGBT, qui dépeignent les affres de l’amour gay. Nous aimons ce qui finit mal, c’est tragique à souhait. Il n’y a pas d’amour heureux, toussa, toussa. Le bonheur nous est suspect. Même si les choses évoluent, les gays occidentaux ont été biberonnés à cette vision pessimiste de l’amour homosexuel : l’optimisme naïf du BL les met mal à l’aise. Ce sont des codes qu’ils ne possèdent pas. Ce qui veut dire que, lorsqu’ils parviennent à produire une histoire d’amour entre hommes pour le petit ou le grand écran, la modalité qu’ils choisissent n’est pas celle du BL.
*
Il est intéressant de noter qu’Heartstopper a été imaginé par une femme, et non un homme gay. Et son succès immédiat, même parmi la communauté gay, est la preuve qu’il existe en Occident un besoin d’histoires d’amour entre hommes idéalisées et optimistes.
Lundi 07 août
Voilà pourquoi 180 Degree Longitude Passes Through Us est une série LGBT et non du BL.
Le scénariste et réalisateur, Punnasak Sukee, est influencé par la littérature et le cinéma gay occidentaux : quand Inthawut fait lire le Banquet de Platon à Wang, l’imaginaire qui est invoqué est celui d’une relation pédérastique entre un éraste et un éromène, c’est-à-dire un homme plus âgé qui s’amourache d’un jeune éphèbe (ici le fils de sa meilleure amie).
Comme il s’agit d’une télésérie LGBT, 180 Degree Longitude explore les conséquences de cet amour naissant, condamné à être avorté. Malgré l’intensité des émotions de Wang, Inthawut, un « vieux gay » qui a intériorisé l’homophobie de sa jeunesse et a vécu sa vie dans le regret et la frustration, se défile dans le dernier épisode. Tout cela démontre encore une fois que, dans la production gay de veine traditionnelle, il n’y a pas d’amour heureux.
Si cette série se démarque des autres productions homoromantiques thaïes, elle sonne aussi un peu faux, comme si on avait forcé l’histoire à prendre une direction qui ne s’imposait pas d’elle-même… Quand les spectateurices savent qu’une fin heureuse est possible (et c’est là toute la force du BL : dire au monde entier que les hommes qui aiment les hommes ne sont pas condamnés au malheur et aux fins tragiques), le pessimisme final (certain·es préféreraient sans doute parler de réalisme doux-amer) apparait comme gratuit et arbitraire.
De nos jours, condamner l’amour queer à la tragédie n’est plus que la marque d’une oeuvre d’art qui veut qu’on la prenne au sérieux, et ce à tout prix.Jeudi 22 juin
Cela fait des années que Stéphane (@SeriesEater) me demande d’écrire une suite aux Chroniques de Dormeveille.
Plusieurs continuations possibles apparaissent sur cette vieille liste… J’avais même commencé à travailler sur un projet qui se passerait à Sheffield et où l’on retrouverait Louis, Roberta et Leigh, avec de nouveaux personnages (dont le demi-frère de Raiden).
Au final, la pandémie et ses confinements à répétition l’auront tué dans l’œuf. Ma tentative de m’approprier Sheffield, comme je l’avais fait avec Oxford, a échoué… et je n’ai plus eu envie de retenter le coup.
Je préfère maintenant retourner dans le monde imaginaire de mon adolescence et oublier que je vis en Brexitland.
Ces dernières années, mes gouts et mes aspirations ont évolué. Je suis certainement plus désabusé que je ne l’étais en 2019… et je ne suis plus celui qui a publié Dormeveille en 2017-18.
J'ai même déserté le milieu du M/M pour squatter celui du BL.
(Les mauvaises langues feront remarquer que le changement est minime : s'il s'agit encore et toujours d'hétéros à moitié à poil qui prétendent aimer d'autres mecs... En somme, le MM et le BL, c'est Tweedledum et Tweedledee avec des pecs et des abdos.)
Mercredi 09 août
Pourquoi est-ce que j’écris ? Je sais pourquoi j’écris ce journal, car ça répond à un besoin que j’ai de clarifier ma pensée et d’en garder la trace. En le publiant, I pay forward, c’est-à-dire que je le partage dans l’espoir que mes lecteurices pourront s’en servir comme un terreau pour leurs propres réflexions, comme j’ai utilisé, et utilise encore, les journaux et les blogs des autres.
Ce qui est moins clair, toutefois, c’est la raison pour laquelle j’écris de la fiction. Peut-être parce que j’ai commencé il y a plus de vingt ans, quand j’étais quelqu’un d’autre, un adolescent, coincé dans sa caverne, qui ne connaissait le monde qu’indirectement, et donc faussement. À l’époque, l’écriture me permettait d’exister. J’avais espoir qu’elle prouverait ma valeur et ma légitimité à vivre dans ce monde dans lequel je ne semblais pas être le bienvenu.
Maintenant, je ne sais plus trop. C’est peut-être pourquoi, depuis quelques mois, quelques années même, j’ai une crise de foi… J’ai besoin de clarifier mes motivations, sans quoi cet entredeux s’éternisera.
Jeudi 10 août
Tentation de dépeindre le parc à côté de chez moi et les effets du soleil matinal sur ce dernier… cette beauté qu’il serait si facile de montrer sur une photo mais que je suis incapable de décrire avec des mots. Il faudrait que j’emploie des artifices littéraires, c’est-à-dire que je remplace une beauté visuelle par l’élégance des mots et de leurs sonorités.
Décrire le parc tel qu’il est : lumière d’or qui traverse horizontalement les branches et se réfléchit sur les feuillages verts ; cette description, pourtant la plus correcte et la plus juste, ne suscite aucune émotion quand on la lit… Or il semble que le plus important dans cet acte de partage soit de provoquer une émotion chez les lecteurices, et donc de recréer artificiellement un émoi, qui n’est pas celui que j’ai ressenti.
Pour être le plus juste, il ne faut donc pas être fidèle à la réalité ; la littérature impose une manière différente de dire le vrai.
Lundi 14 août
‘We don’t turn to story to escape reality. We turn to story to navigate reality.’
*
‘The power of story is rarely on our radar. Instead, we put our faith in the power of the beautiful words themselves to lure readers, thus mistaking the wrapping paper for the present.’
(Lisa Cron, Story Genius)
Mardi 15 août
J’ai un fichier intitulé Vademecum de l’écrivain, dans lequel je note au fil de l’envie et des besoins des informations utiles pour mes écrits : méthodologies d’écriture, listes de prénoms, traits de caractère, incises de dialogues, etc., etc.
Dans un monde idéal, je le remplirais systématiquement ; le contenu, ordonné, pourrait être partagé avec la communauté… et nous pourrions créer tous ensemble une encyclopédie pratique de l’art d’écrire.
Mercredi 16 août
Que des gens puissent traverser leur vie sans vouloir se connaitre me laisse perplexe. C’est une attitude à l’opposé de la mienne. La seule mission qui compte à mes yeux, c’est découvrir qui l’on est. Il ne s’agit pas là d’égoïsme ou d’égocentrisme : quand on se connait, on interagit mieux avec son environnement. Après tout, nul humain est une ile. Ce qui sépare la vie intérieure de l’extérieur est très poreux : les deux s’influencent constamment. Quand on améliore l’une, l’autre en profite pareillement.
Nous n’avons qu’une vie : n’est-il pas vital de comprendre qui se cache derrière ce « je » ?
Samedi 19 août
À la bibliothèque de Sheffield, j’ai trouvé What Makes This Book So Great de Jo Walton, un recueil de ses chroniques publiées sur Tor.com de 2008 à 2011.
Plutôt que de chroniquer les dernières sorties, l’écrivaine de SF britannique, qui vit au Canada, partage les réflexions que lui inspirent ses relectures : c’est l’occasion de revisiter ces grands romans de fantasy et de science-fiction et de mettre en avant les éléments qui justifient qu’on les relise.
*
Je crois avoir déjà noté ici que ce qu’il manque au genre de la romance, c’est ce type d’initiatives patrimoniales. La romance est encore un genre anhistorique, ou plutôt dont l’histoire est si peu connue par ses lecteurices que c’est comme si elle n’en avait pas. La SFFF, au contraire, que ça soit dans l’anglophonie ou la francophonie, dispose d’une histoire qui est mise régulièrement en avant (ce qui a certainement facilité son entrée dans le milieu académique). Il y a des listes de « classiques » que chacun se doit d’avoir lus — ou du moins de connaitre. On réédite même des romans du XIXème ou de la première moitié du XXème siècle (avec plus ou moins de bonheur).
La romance, quant à elle, prétend qu’elle n’a pas de passé et n’écrit que pour l’ici et le maintenant : les nouveaux romans semblent effacer les anciens… Je soupçonne que tout cela changera dans les années à venir : après le polar et la SFFF, c’est autour de la romance d’acquérir ses lettres de noblesse, et pour cela, elle doit mettre au jour sa généalogie.
Dimanche 20 août
« En science-fiction, on peut avoir n’importe quel type d’histoire — une romance, un roman policier, une réflexion sur la nature humaine, ou rien du tout. Et les possibilités sont infinies. On peut raconter des histoires différentes sur la nature humaine quand il est possible de la comparer à la nature d’un androïde ou d’un extraterrestre. On peut l’examiner sous un angle différent quand on écrit sur des gens qui vivent deux siècles, sont séparés par des années-lumière ou sont victimes d’une malédiction. On a davantage de couleurs sur notre palette, davantage de lumières pour illuminer notre scène.
Mais le problème avec les littératures de genre, c’est que les auteurices s’emparent de ces lumières et de ces couleurs supplémentaires pour les mettre partout, comme si le fait que le résultat soit coloré ou brillant se suffisait à lui-même, ce qui est loin d’être le cas malheureusement. Ainsi, l’échec le plus fréquent des littératures de genre, c’est d’avoir des histoires superficielles avec des personnages peu convaincants qui sont seulement rachetés par les machinations d’un sorcier maléfique, par l’économie fascinante du transport interstellaire, etc.
Ce que je veux, c’est des histoires aussi bien écrites et caractérisées que Middlemarch, mais avec davantage de possibilités dans le déroulé de l’histoire. C’est ce que j’espère toujours, et c’est ce que j’obtiens quand je lis le meilleur de la SF. »
Jo Walton, What Makes This Book So Great (2014, trad. d’Enzo Daumier)
Mercredi 30 août
Wedding Plan, c’est fini. J’ai apprécié le format court : sept épisodes n’autorisent aucune longueur. C’était mignon, ça se termine bien (normal, c’est un BL — duh). En particulier, le dernier épisode est très bien fait, avec quelques scènes hilarantes. C’est rare de finir en beauté, mais MAME, la créatrice de la série, y parvient sans trop de mal.
Mais, comme avec beaucoup de BLs, ça manque d’ambition. Sans parler de Namnuea qui manque de mordant… Et dans ce genre d’histoires (où le futur marié tombe amoureux de son wedding planner), des personnages narquois ou sarcastiques seraient presque une obligation : un caractère doux et mignon semble mal adapté à la situation.
Dans Wedding Plan, il y a de nombreuses scènes où Lom est le top-dominateur typique et Nuea la donzelle effarouchée. Ces tropes sont les moins intéressants que le BL ait à offrir. J’irai même plus loin : ils n’existent que pour satisfaire un public féminin biberonné aux séries romantiques hétéros classiques. Quand le BL met en scènes ces tropes, il se range du côté de l’hétéronorme et cesse de proposer un discours intéressant sur l’amour ou le fait d’être queer. Il devient insipide : ça n’empêche pas de passer un bon moment (qui n’aime pas les sucreries ou la barbe à papa ?), mais aussitôt vu aussitôt oublié.
Jeudi 31 août
Il n’existe pas de BL idéal… N’importe quel trope fonctionne tant qu’on l’emploie intelligemment.
Je suis sûr qu’on finirait par me faire aimer un top dominateur et un bottom soumis (même si ce n’est pas gagné d’avance !).
Le problème, c’est quand l’équipe créatrice, ne souhaitant pas remettre en cause les lieux communs, préfère enfiler les clichés les uns après les autres. Elle produit une soupe indigeste, divertissante au mieux, au pire insupportable. (Imaginez le résultat quand on ajoute de mauvais acteurs.) Afin de donner naissance à des histoires intéressantes et mémorables, il faut aimer le genre du BL avec une passion féroce, mais cette dernière ne saurait être aveugle : un œil critique, porté sur la production précédente, est indispensable. Qui aime bien châtie bien. Sans exigence, on ne crée rien de bon.