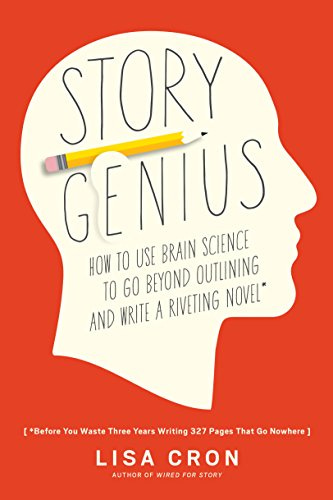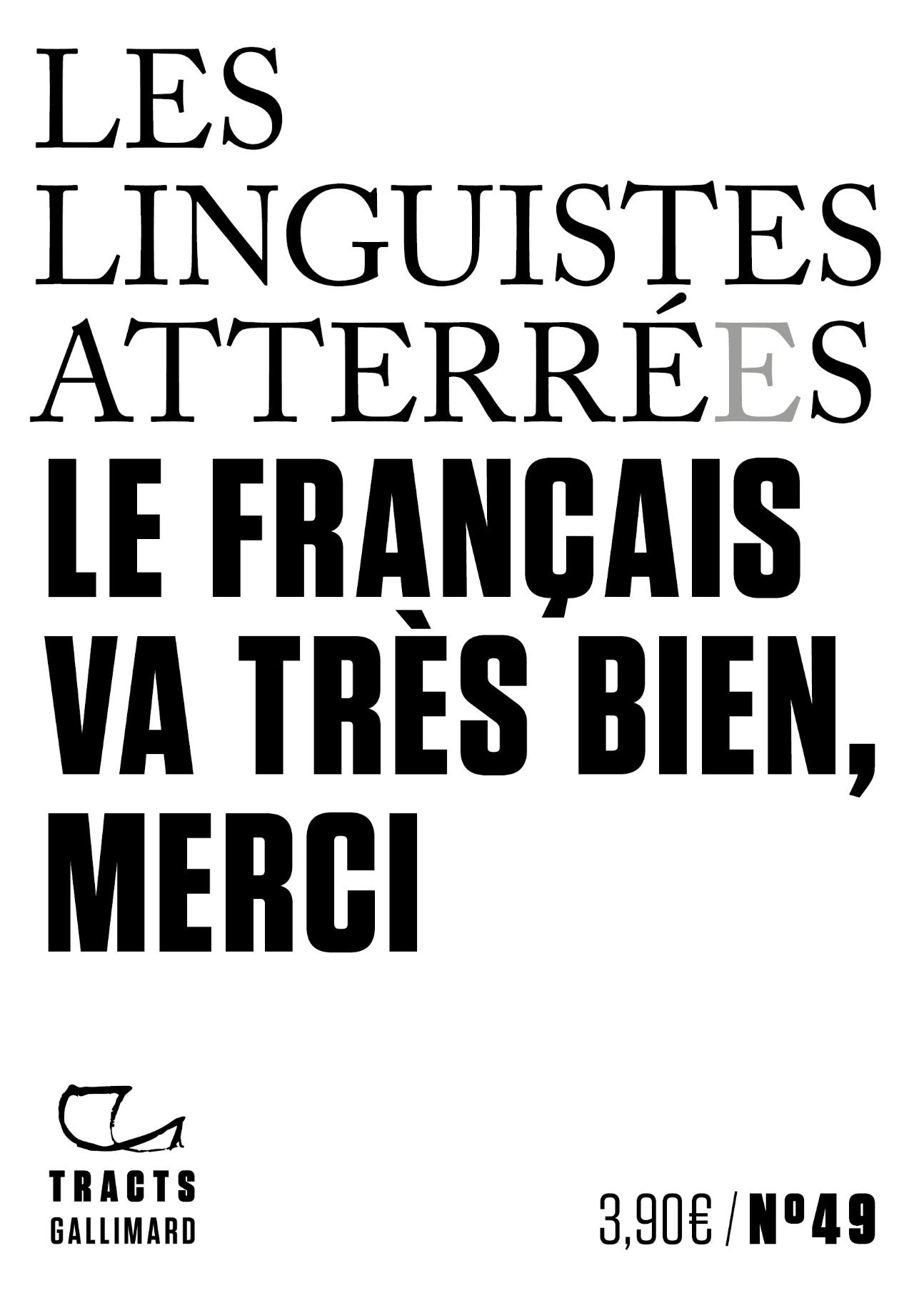Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.
La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.
So long!
Enzo
Lundi 01 mai
Je préfère les séries taïwanaises aux séries chinoises, même si ces dernières sont, dans l’ensemble, de bien meilleure qualité.
Pourquoi donc ? Peut-être parce que la sensibilité taïwanaise est plus proche de la nôtre (l’influence américaine se fait sentir). Taïwan regarde à l’international quand la Chine se regarde le nombril (et quel nombril !).
Le mandarin parlé à Taipei est saupoudré d’expressions anglaises (ce qui doit renforcer cette impression de familiarité que j’éprouve) ; les personnages féminins ne se limitent pas aux nunuches soumises au patriarcat (thank Heavens!) ; ces dernières années, les rôles se sont diversifiés, on peut voir les minorités à l’écran, même dans des séries mainstream.
Mardi 02 mai
Le langage littéraire, nous dit-on, devrait se méfier du familier, comme si ce registre était un peu trop près de son cousin honni, le vulgaire. Parfois, cette suspicion va jusqu’à s’étendre au registre courant : pour certain·es, la (bonne/vraie) littérature ne devrait être que soutenue.
Personnellement, je fais feu de tout bois. Peu m’importe si telle expression est soutenue, courante ou familière. Je suis pour un panachage des registres, un style qui s’éloigne de la rigueur austère du classicisme et embrasse la variété.
Quand je me suis exilé, j’ai dû laisser derrière moi toute prétention au « bon gout », si tant est que je l’aie jamais acquis. Les années passant, je développe un rapport pragmatique à ma langue maternelle ; sa sacralité me parle de moins en moins.
J’aime les mots rares, les malfamés, les coquins, les régionalismes et ces expressions issues de tous les coins de la francophonie. De plus en plus, j’aime le français pour ce qu’il est, et non ce qu’il devrait être.
Évidemment, je trouve encore en moi des fantasmes de langue pure et élégante, froide et belle comme la plume de Yourcenar… Ils sont là, je ne peux pas le nier, mais leur attrait diminue avec l’âge au point que j’espère les voir se dissoudre entièrement.
Mercredi 03 mai
Face à tous ces déclinologues de la langue française, je veux célébrer la vitalité contemporaine de cette langue qui m’aide à penser chaque jour, mais qui n’est pas celle qui m’entoure continuellement et avec laquelle j’aime et je travaille (l’anglais).
Je veux me concentrer sur la joie et l’émerveillement linguistiques ; et oublier la peur scolaire de la faute, la crainte sociale du ridicule. Ma langue maternelle n’est pas langue de discrimination ; je la veux à l’image de mes valeurs : inclusive, tolérante, progressiste.
Peut-être que certains usages me choquent, que je ne comprends pas l’apparition de certaines expressions et que j’ai parfois l’impression que leur français n’est pas le mien… Mais peu importe, car le français leur appartient autant qu’à moi. Ils ont la liberté d’en faire ce qu’ils veulent ; et j’en ferai de même de mon côté.
Jeudi 04 mai
Le couronnement de Charles approche.
Au bureau, quelques discussions sur la famille royale : une telle trouve que Charles et Camilla sont des âmes sœurs ; une autre que Camilla est evil et Diana pas aussi parfaite qu’on a voulu nous le faire croire. Presque tout le monde espère que William remplacera vite son père. On s’intéresse déjà à George. Mais personne ne semble prêter attention à la réalité de la monarchie : on s’arrête au symbole, aux rêves. On ne veut pas penser au fait que le roi ne paie pas d’impôts sur les successions, est souvent au-dessus des lois (les eaux troubles du King’s Consent) et n’a aucune légitimité (qui l’a choisi, si ce n’est maman et… Dieu ?).
Quand je fais remarquer tout cela (comme je suis français, on attend de moi que j’occupe la position antimonarchique et républicaine — what can I say?), on me dit que les alternatives ne sont guère meilleures : apparemment, élire un chef d’État, avec la corruption de la classe politique, ne résoudrait aucun problème…
Cela veut-il dire qu’un nombre (trop) important de la population serait satisfait de ne pas avoir d’élections et de vivre en autocratie ? Peut-être.
Mais en réalité, je crois de plus en plus qu’une frange importante de mes concitoyens et de mes concitoyennes préfère le statu quo, les traditions, même imparfaites et révoltantes, tant que cela leur permet de ne pas penser à des alternatives (même si ces dernières leur seraient plus profitables).
Le connu réconforte même quand il est inconfortable.
Vendredi 05 mai
Selon notre tempérament, nous portons un regard positif ou négatif sur les choses de la vie.
Dans l’ensemble, l’existence, c’est un verre à moitié rempli : il n’est pas vide, il n’est pas plein, mais nous avons tous·tes une opinion tranchée sur le sujet.
On a l’impression de deux camps irréconciliables, chacun ayant sa vérité et la défendant mordicus. L’un·e ne voit que le vide, l’autre que l’eau. Pénurie/rareté versus abondance. Deux visions du monde qui s’opposent.
En réalité, les deux camps ont raison : tout dépend de ce à quoi on prête attention.
Le même mécanisme est à l’œuvre pour ce qui est de la nature humaine : l’être humain est-il bon ou mauvais ? Prenez un siège, placez vos paris.
*
Spontanément, je doute des gens, de leurs motivations et je suis prompt à blâmer autrui (et moi-même davantage, sinon ça ne serait pas drôle).
Quand je regarde l’état de notre planète, les pensées négatives m’assaillent. Autour de moi, je vois tout ce qui manque et tout ce qui va mal… mais j’ai compris que cette manière d’appréhender le monde (en plus de me rendre malheureux) n’est pas plus correcte que l’optimisme et la générosité d’esprit des voisin·es.
Mon misérabilisme naturel ne me donne pas une vision plus réaliste, plus vraie du monde, contrairement à ce que je peux croire et à ce que beaucoup de gens affirment.
Voir le bien et l’abondance, ce n’est pas pour autant ignorer le mal et la rareté ; ce n’est pas porter des œillères et se boucher les oreilles. C’est simplement entretenir l’émerveillement au quotidien, c’est ouvrir ses yeux et remarquer ces petits détails, comme cette jolie fleur qui pousse au milieu des détritus. C’est ce focaliser sur le positif. C’est faire le pari du bonheur.
Lundi 08 mai
Ce matin, je suis d’humeur à écrire un dictionnaire amoureux du BL, de l’homoérotisme, voire de l’homosexualité (soyons fou !).
Cette idée me trotte dans la tête depuis quelques années. Qui sait sur quoi elle débouchera un jour. Peut-être sur un ouvrage semblable à Un savoir gai de William Marx, mais plus populaire dans sa forme comme dans son fond (de toute évidence, je ne serai jamais professeur au Collège de France ni publié aux Editions de Minuit).
J’aimerais pouvoir expliquer d’où vient le Boys' Love, ses tropes, ses filiations, ses influences. Une production artistique ne naît pas ex nihilo, elle s’inscrit toujours dans un contexte.
J’aimerais parcourir le M/M, le Yaoi, le Danmei… voir, lire, écouter… pas de façon systématique (je n’aurai jamais ni le temps ni l’argent), mais en promeneur dilettante.
Un guide peut-être… (venez vous perdre en ma compagnie ; I swear, it’s gonna be fun! We’ll see some nice bums.)
Les miscellanées, les notes, les traces (insérez ici d’autres termes de formes brèves) de Monsieur Daumier… ou plutôt, le temps que j’écrive tout ça, de Papy Daumier (on pourra alors sous-titrer « Notes d’un vieux pervers »).
Mardi 09 mai
Je me replonge dans le monde de Le Guin, en lisant la monographie d’ActuSF, dirigée par David Meulemans. D’excellente qualité, elle couvre l’ensemble de son œuvre, sans ignorer sa poésie, ses traductions ou ses récits réalistes.
*
Quand on voit les changements de ces dernières années, je me demande s’il est possible d’avoir une carrière comme celle de Le Guin. Elle-même, au crépuscule de son existence, dans les toutes dernières interviews, doutait qu’elle eût pu y arriver si sa carrière avait débuté aujourd’hui.
*
La multiplication des livres édités, tout en offrant à chaque lecteurice la possibilité de trouver ce qu’iel aime, empêche l’émergence des classiques de demain. Ils se noient dans la masse. Le système éditorial, lui-même, n’a plus aucun désir patrimonial (sauf quand il s’agit de garder les droits pendants des décennies, juste au cas où).
*
Pour devenir un·e auteurice incontournable du genre, un·e auteurice culte en somme, il semble qu’il faille écrire jusqu’à un âge avancé : c’est le seul moyen de rester dans les mémoires. En tout cas, c’était le cas pour les auteurices qui ont émergé dans la seconde moitié du XXè siècle (Le Guin, Atwood, Rushdie, King, etc.).
*
Un genre qui semble incapable de se soucier de questions patrimoniales : la romance. À part Jane Austen, où sont les classiques du genre ? Peut-être que l’idéal amoureux est ce qui vieillit le plus vite et le plus mal. Lire une romance vieille de quarante ou cinquante ans, c’est parfois avoir l’impression de faire une fouille archéologique.
Le jour où la romance sera étudiée en classe et à l’université, qu’elle deviendra respectable (comme les littératures de l’imaginaire ont fini par le devenir petit à petit, bon gré mal gré), un canon se mettra en place.
Mercredi 10 mai
Imaginons un matriarcat triomphant. Serait-il différent du patriarcat actuel, et en quoi ?
Nous aurions un monde avec moins de guerres et davantage d’empathie, peut-on lire ici et là. (Ce qui serait certainement vrai si nous avions davantage de femmes politiques comme Jacinda Ardern à la tête de nos nations, ici et maintenant.)
Mais les dynamiques de pouvoir changeraient-elles radicalement si nous remplacions un gender par un autre ? Après tout, il s’agit de l’exploitation d’un sexe par un autre : les mêmes mécanismes de domination seraient à l’œuvre.
Je ne crois pas que les filles soient plus douces et les garçons plus violents : ces traits de caractère, ces comportements sont en grande partie modelés dès l’enfance par l’entourage, consciemment ou inconsciemment.
Le matriarcat pourrait donc nourrir l’agressivité (et ses formes atténuées, comme l’intrépidité, l’esprit d’aventure, etc.) chez les filles et la neutraliser le plus possible chez les garçons.
(Le Guin, pour sa part, considérant que l’agressivité est naturelle chez les hommes, imagine une société où ils sont parqués dans des fuckeries et où des joutes sont organisées pour canaliser leur violence. Soit.)
*
Le plus dur n’est pas d’imaginer une alternative où les minorisé·es prennent le pouvoir (dans le cas présent, remplacer le patriarcat par le matriarcat). Instinctivement, nous comprenons les mécanismes de domination (nous les subissons chaque jour, d’une manière ou d’une autre).
Le plus dur, c’est d’imaginer une société qui s’en serait entièrement débarrassée.
Jeudi 11 mai
5ème mois. 19ème semaine.
L’écriture de ce journal se poursuit bien au-delà des trois mois que je m’étais fixés. Peut-être arriverai-je même jusqu’à douze mois : une année entière à noter mes réflexions et mes observations, ça serait bien. Cet embryon de constance m’impressionnerait presque.
2023, l’année de l’écriture diaristique.
Mais je m’avance : dépassons les six mois avant d’avoir l’ambition de tenir toute une année.
*
Si j’écrivais un roman, au bout de tant de temps, j’aurais une idée assez claire de ce que je veux raconter, de la direction prise et à prendre. Les pages rédigées commenceraient déjà à former une œuvre, un tout, certes imparfait, mais qui ressemblerait à quelque chose.
Ce journal ne forme pas un tout : il a un début identifiable, mais le milieu et la fin n’existent qu’en théorie. Nouveau mode de composition pour moi, comme on tricoterait une écharpe sans fin, et sans se soucier du motif ni des couleurs. Pris dans le quotidien, j’avance à l’aveugle. La sensation n’est pas désagréable : il suffit d’être présent… venir écrire quelques lignes, sans se soucier de ce qui précède et sans trop s’inquiéter de ce qui suivra.
Vendredi 12 mai
Pour tout projet qui me semble important, il faut que j’aie tout préparé avant que de commencer. J’ai besoin d’un plan d’attaque, d’une méthode, de temps pour réfléchir… J’oublie que le plus important, c’est de se lancer. Le reste peut se mettre en place petit à petit.
La peur me fait procrastiner : « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ! ». Un seul geste s’impose alors : celui de me pousser à l’eau.
Samedi 13 mai
Si j’avais vécu en France, je n’aurais certainement pas eu cette impression constante de perdre ma langue maternelle. De la voir se scléroser, se déliter, s’angliciser. (Je suis devenu comme ces vieux auteurs latins qui soupiraient que « c’était mieux avant ». Ce que c’est que mal vieillir quand même !)
Ça n’affecte pas ma compréhension, bien évidemment… Mais des pans entiers de mon vocabulaire deviennent inaccessibles quand je veux les utiliser. Instinctivement, je sais qu’il existe une expression pour ce que je veux exprimer, mais j’ai beau chercher, je ne trouve rien que son contour, sa forme, sa trace : comme si mon cerveau avait nettoyé la scène du crime, mais qu’on voyait encore la position exacte du cadavre. « Tu vois, elle était là ; elle existe bien ! »
*
Peut-être que si je vivais en France, mon obsession de la langue s’exprimerait différemment. À la place de la perte, j’éprouverais un sentiment d’insuffisance ou, qui sait, de décalage. (Malheureux un jour, malheureux toujours.)
*
Cette perte est, évidemment, une libération. Quand on voit sa langue maternelle comme une langue étrangère qu’on ne maîtrise plus très bien, on adopte un rapport plus détaché, plus humble aussi, et on repousse les limites de ce que l’on jugeait acceptable avant de s’exiler. On remet en question les postulats linguistiques et stylistiques, toutes ces idées reçues qu’on prenait pour argent comptant. En somme, on fait du ménage, et ça fait un bien fou.
*
Plutôt que de gémir comme une tragédienne sur ce que je n’ai pas ou plus, je pourrais accepter la situation telle qu’elle est et faire de cette faiblesse supposée une force. (Le verre à moitié plein, toussa, toussa.)
Dimanche 14 mai
Question de Bernard Henninger : « Avez-vous des critères particuliers pour écrire une nouvelle ou un roman, ou suivez-vous juste votre intuition, votre inspiration ? »
Réponse d’Ursula Le Guin (datée de 2010) : « Je n’ai aucun critère en dehors de certaines préférences d’ordre stylistique : la clarté de la langue, la précision et la richesse de la description, la variété du rythme, et, de plus en plus, la suggestion plutôt que l’explication, l’allusion plutôt que la déclaration. Les sonorités, le rythme de la prose sont extrêmement importants à mes yeux. L’intrigue en elle-même ne m’intéresse pas ; en revanche, la progression du récit, la narration est pour moi primordiale. »
Lundi 15 mai
Les idées vont et viennent.
Je suis allergique aux notes (j’ai fait une scolarité entière où j’en ai pris le moins possible, préférant multiplier les sources d’information plutôt que relire cent fois la même chose). Longtemps, j’ai considéré que ma mémoire retiendrait ce qui méritait d’être retenu. Good ideas stick, right?
Depuis que j’ai dépassé la trentaine, je suis toujours aussi allergique à la prise de notes, mais mon cerveau (débordant de détails superflus ?) semble avoir décidé de tout expurger, même l’utile, même l’important. Je ne peux plus lui faire confiance pour se rappeler ces idées fugaces, les triviales comme les chatoyantes.
Dernier exemple en date : hier, j’avais une idée intéressante pour une entrée de ce journal. J’étais sur le point de la noter (oui, elle était à ce point engageante que je voulais la préserver !), mais j’ai été distrait (par quoi ? j’ai oublié) et, pouf, now it’s gone. Je ne sais même pas le thème général, il ne reste aucun indice qui me permette de remonter sa trace. Je me souviens juste que j’avais une idée. La belle affaire ! À oublier, n’aurais-je pas pu tout oublier ? Ç’aurait été moins frustrant.
Mardi 16 mai
Triste que, dans les médias, on laisse le Figaro s’emparer de la langue française et des lettres classiques. On dirait qu’il n’y a que ce journal pour parler de ces deux sujets. Où sont les voix de gauche, où est l’approche progressiste ? Il ne faut pas s’étonner si ça finit par sentir le rance.
Les gens associent les antiquités méditerranéennes (le pluriel ici s’impose) à un élitisme puant et rétrograde : comment pourrait-il en être autrement si les seuls échos qu’ils entendent viennent de ce journal conservateur ?
S’intéresser à l’histoire, ce n’est pas être nostalgique d’un monde qui n’est plus ou utiliser le passé pour dénoncer le présent et refuser le futur. Le « c’était mieux avant », que l’on retrouve dans tous les discours du Figaro sur le français, l’histoire et les belles lettres, me fatigue (en plus d’être faux).
Mercredi 17 mai
De plus en plus, j’ai besoin de me rappeler que ce qui a eu lieu il y a 7, 10, 15 ans ne mérite pas d’occuper la scène de mon espace mental. Revivre les premiers drames professionnels, les relations amoureuses (réelles comme avortées), les déceptions surtout (bien plus que les joies), n’apporte rien quand on a déjà tiré les conclusions qui s’imposaient… et que le moi d’alors n’est plus le moi de maintenant.
Que d’énergie gâchée à échafauder des scénarios, des what-ifs, au sujet d’événements, de situations, de moments de mon existence qui ne se représenteront plus ! Le plus souvent, le passé mérite de rester dans le passé.
Jeudi 18 mai
Je juge certaines personnes de mon entourage professionnel avec dureté. J’accepte les défauts des gens (j’en ai beaucoup moi-même), mais je ne supporte pas l’incompétence.
Les pires, ce sont ces incompétents gentils, que l’on aimerait détester mais qui sont des gens bien sur le plan humain. Des mauvais collègues qu’on critique avec culpabilité, car on s’entend bien avec eux… mais dont le comportement professionnel nous afflige, surtout s’ils s’avèrent être des managers…
Je préférerais avoir affaire à des collègues haïssables, ça simplifierait les rapports et chasserait toute trace de culpabilité.
Samedi 20 mai
La citation d’Ursula Le Guin que j’ai lue (et citée ici) le week-end dernier m’a clarifié l’esprit.
Depuis, un résumé de ce qu’elle y déclare est punaisé sur le panneau en liège au-dessus de mon ordinateur : clarté de la langue, précision et richesse de la description, variété du rythme… autant de caractéristiques avec lesquelles je suis en accord (et qu’il me suffira d’appliquer au moment venu — c’est, en tout cas, la théorie).
Quant au reste, qui me parle moins pour ainsi dire, je le digère petit à petit.
*
Cette semaine, j’ai aussi travaillé avec plus de régularité sur mes Récits Péninsulaires : je me rapproche du jour fatidique où je pourrai commencer l’écriture.
Mais j’en suis encore loin pour le moment : je veux prendre le temps de repenser mon monde, de le dépoussiérer, de le changer en profondeur si besoin.
Quand on habite un univers depuis vingt ans, c’est commode d’emprunter les mêmes chemins sans y penser. Le terrain a été balisé, la promenade promet d’être facile, mais la destination demeure identique. Si on désire découvrir quelque chose de nouveau, il faut diriger son regard là où il ne s’est jamais porté, il faut se rendre là où les sentiers n’existent pas encore.
Je veux que le monde et les histoires que je vais raconter soient à l’image du voyageur que je suis maintenant et non de l’adolescent pérégrin que j’étais alors.
Évidemment, je ne compte pas faire table rase du passé (l’essence de la Péninsule, et de certains personnages, restera la même), mais je suis déterminé à mettre un point final à ce projet sans fin, et pour ce faire, les réajustements, ou les réactualisations, sont indispensables.
Dimanche 21 mai
J’affectionne l’anglais, car c’est, à mes yeux, une langue plus directe que le français : une langue tournée vers l’action, qui, bien que littéraire quand elle le souhaite, refuse d’être ampoulée.
En comparaison, le français aime la complexité. Son « bon style » n’est pas démocratique, mais élitiste. Purisme et pédantisme avancent main dans la main et semblent régner en maître dans les milieux littéraires. La simplicité, loin d’être un idéal, devient synonyme de pauvreté. On voue un culte à la correction la plus absolue et aux règles d’accord byzantines.
C’est pourquoi on écrit des livres sur le « français correct » tandis qu’outre-Manche ou outre-Atlantique, on préfère se concentrer sur le « plain English ».
Lundi 22 mai
Évidemment, je préfère l’anglais parce que ce n’est pas ma langue maternelle et que je l’aborde en étranger, comme Beckett aimait le français, car il lui permettait une simplicité stylistique que la langue de sa jeunesse lui refusait…
*
Tout est une question d’exigence, en somme. En anglais, je supporte tous les styles, même les plus insipides ! Il faudrait vraiment que la qualité soit mauvaise pour que je ne dépasse pas le premier paragraphe : seules les erreurs grammaticales m’horripilent.
Mardi 23 mai
D’après Lisa Cron (Story Genius), on lit avant tout pour l’histoire. Toutes les marques du littéraire (style, intrigue, etc.) sont des hors-d’œuvre ; l’histoire serait le plat principal. C’est ainsi, en tout cas, qu’elle justifie le succès impressionnant de Cinquante Nuances de Grey : si les gens voulaient avant tout des romans bien écrits, personne n’aurait entendu parler de la trilogie d’E.L. James.
Elle remarque aussi que nous peinons à expliquer ce qui constitue une bonne histoire (nous le sentons instinctivement) ; en conséquence de quoi, nous nous rabattons sur des éléments plus facilement repérables comme les phrases d’un·e auteurice.
Évidemment, elle ne veut pas dire que l’intrigue, le style ou la voix d’un·e auteurice n’importent pas. Nous confondons simplement l’arbre et la forêt ; nous relevons des éléments de surface que nous prenons pour l’essence même du roman.
Et dès les bancs de l’école, on nous enseigne cette vision superficielle de l’écriture… ce qui expliquerait pourquoi tant de romans, peaufinés pendant des années et des années, fruits d’un labeur acharné, échouent à nous enchanter.
Mercredi 24 mai
Je lis un article sur Yourcenar et la politique (« Marguerite Yourcenar était-elle de droite ? »).
*
Comment doit-on juger un·e auteurice quand on a accès à toute son œuvre et à toute sa vie ? Ses opinions de jeunesse importent-elles davantage que ce qu’iel affirmait à cinquante ans, puis à soixante-dix ans ? Peut-on réduire une longue vie faite de mini-révolutions à quelques idées générales ? Que se passe-t-il quand le chemin parcouru est si long que la destination se trouve à l’opposé du point d’origine ? Quelle position politique retient-on ? Celle qui nous arrange ou celle que nous abhorrons ? Pardonnons-nous les errances de jeunesse ? Essayons-nous de justifier la sclérose rance de l’esprit qui a débarqué en même temps que les rhumatismes ?
Et si l’auteurice s’est montré·e peu prolixe en discours politiques, doit-on passer son œuvre au peigne fin pour essayer de déterminer si iel était plutôt progressiste, plutôt conservateurice ?
Et à partir de quel moment après sa mort les opinions politiques d’un·e auteurice n’importent-elles plus ? Un siècle peut-être, deux grand maximum ?
*
Le XXe siècle est encore trop proche de nous pour que nous cessions d’être intéressés par les positions politiques de nos grands écrivain·es, qu’iels aient été engagé·es ou non. Mais arrivera un temps où leurs préoccupations politiques ne seront plus vraiment les nôtres et nous lirons leurs œuvres comme des représentantes de leur siècle, ni plus, ni moins, sans nous soucier de savoir si elles étaient à gauche ou à droite…
Jeudi 25 mai
Le soleil et les températures clémentes sont enfin de retour. On ne sait combien de temps cela va durer (la grisaille caractérise Sheffield et le thermomètre peut s’effondrer du jour au lendemain).
J’ai peu de problèmes avec les températures fraîches, mais depuis que nous avons déménagé dans le Yorkshire, l’absence de franc soleil est ce qu’il y a de plus difficile à vivre.
Si j’en crois les statistiques, Oxford comptabilise 1615 heures d’ensoleillement tandis que Sheffield peine à arriver à 1485 heures (d’ailleurs, il y pleut plus souvent). En comparaison, Édimbourg, bien plus au Nord, accumule 1450 heures… et je découvre que Lincoln fait mieux qu’Oxford avec ses 1631 heures. Il est donc temps que je prépare mes bagages et parte m'installer dans le Lincolnshire.
Vendredi 26 mai
« Nous, linguistes, sommes proprement atterrées par l’ampleur de la diffusion d’idées fausses sur la langue française, par l’absence trop courante, dans les programmes scolaires comme dans l’espace médiatique, de référence aux acquis les plus élémentaires de notre discipline. L’accumulation de déclarations catastrophistes sur l’état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre son immense vitalité, sa fascinante et perpétuelle faculté à s’adapter au changement, et même par empêcher de croire à son avenir ! Il y a urgence à y répondre. »
*
Les « linguistes atterré·es » viennent de lancer une contre-attaque. Tremble, Figaro ! Tremble, Académie Française ! Iels ne vous laisseront plus dire des conneries sur la langue française. Vos délires linguistico-apocalyptiques sur le déclin national vont, enfin, se heurter aux études scientifiques sur le terrain, à la dure réalité.
*
Comme il semble que les questions de langue échauffent davantage l’esprit gaulois que la crise climatique (chacun ses priorités, comme on dit), nous pourrions avoir affaire à une querelle plus grande encore que celle de l’écriture inclusive et de la féminisation des noms de métier.
Sortez votre popcorn, it’s going to be entertaining.
Samedi 27 mai
Pendant longtemps, Doctor Who (la saison 4 en particulier) et Being Erica (2009-11) ont été les seules séries que j’ai eu envie de revoir plusieurs fois.
Being Erica, en particulier, m’a aidé à supporter ma dépression d’alors : j’avais 23 ans et l’impression d’avoir (déjà !) raté ma vie. Comment ne pas s’identifier au personnage d’Erica, cette jeune trentenaire qui démêlait ses innombrables regrets ? Cette série était fantastique, à tous les sens du terme !
J’ai oublié les 3/4 de ce qui se passe dans les quatre saisons, mais demeure une profonde affection pour Toronto et Erin Karpluk.
*
Cette semaine, je me suis mis à reregarder quelques séries coréennes : What’s Wrong with Secretary Kim (vue en septembre 2021, au début de mon exploration des productions asiatiques) et Business Proposal (avril 2022). Plutôt dans le mois, c’était le BL Blueming.
L’occasion de vérifier ce dont je me souviens (parfois très peu, parfois des pans entiers de l’histoire)… et de passer un bon moment. Sans oublier que le storyteller en moi analyse ces séries et se demande comment il les raconterait dans un roman.
*
De plus en plus, je vois l’intérêt de replonger dans des œuvres que l’on a déjà parcourues, fussent-elles des livres, des séries ou des films, plutôt que de toujours aller de l’avant et d’explorer le catalogue sans fin que notre monde contemporain ne cesse de produire. Plus jeune, je pensais que les relectures étaient une perte de temps (so little time!, so many books!), mais j’ai compris que visiter des histoires déjà connues fait du bien à l’âme et enrichit différemment.
Dimanche 28 mai
J’admire autant que j’envie mon mari qui n’est sur aucun réseau social. J’en suis incapable, en partie parce que je suis un auteur autopublié (maintenir un semblant de présence en ligne permet de croire qu’on existe).
Je ne peux pas compter sur un éditeur pour diffuser mes textes et faire connaître mon nom (mais il semble que le milieu de l’édition compte de plus en plus sur les auteurices pour faire leur propre promotion ; une situation ridicule que nous acceptons, puisque le rapport de force ne joue pas en notre faveur…).
Je vis à l’étranger entouré de gens qui ne peuvent pas me lire — sans les réseaux sociaux, je me sentirais encore plus seul que je ne le suis déjà ; je serais coupé de ce qui se passe en France (imaginez : plus de débats sur le voile ou sur les dangers mortels qui menacent la langue française — without them, how would I survive?!).
Alors, je reste sur Twitter (et fais semblant d’être sur Instagram), croyant que ça me permettra d’être lu, le jour où je déciderai de publier un nouveau texte. Mais en réalité, je doute que ma présence sur les réseaux sociaux ne me donne jamais cette visibilité à laquelle j’aspire.
*
En attendant, quand je scrolle sans fin sur Twitter ou Insta, je peux voir les acteurs de mes BLs préférés à moitié dénudés : c’est une occupation saine et enrichissante, a life worth living, n’est-ce pas ?