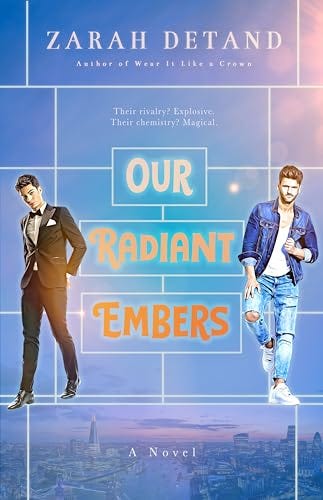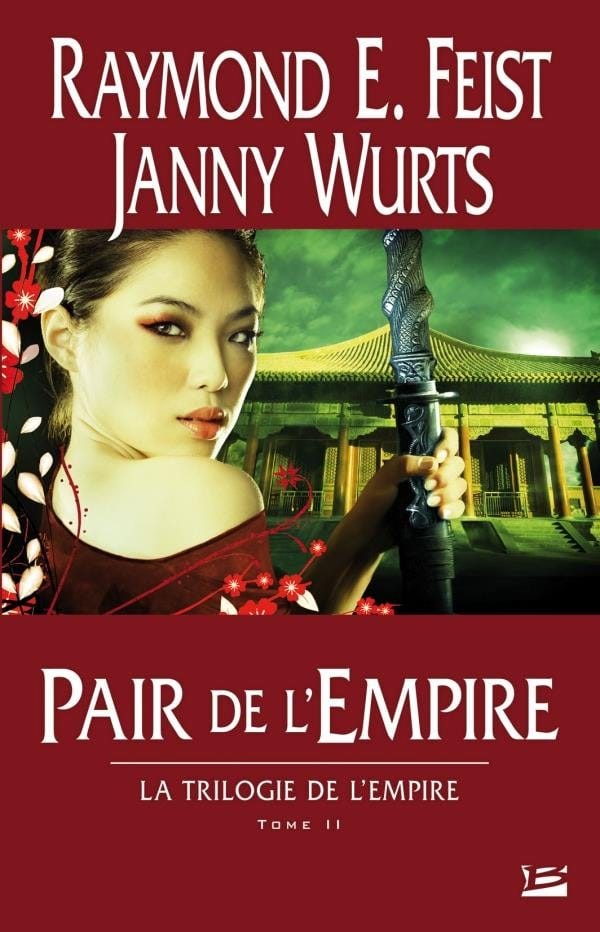Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.
La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.
J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.
So long!
Enzo
Samedi 01 juin
Visite à la librairie d’occasion de Kelham Island, où le petit rayon de littérature en langue française avait de nouveaux bouquins.
J’ai acheté Mythologies de Barthes, les Nouvelles romaines/Racconti romani de Pier Paolo Pasolini en édition bilingue et les Nouvelles complètes de Marcel Aymé publiées chez Quarto Gallimard.
Des achats découverte, en somme, car le seul que j’ai jamais lu, c’est Barthes (durant mes études littéraires, il y a une éternité). Pasolini et Aymé, je ne les connaissais que de nom. (Et encore… Aymé m’est pour ainsi dire inconnu.)
Sur trois auteurs, deux sont homosexuels : c’est pas mal pour un premier jour du Pride Month.
Dimanche 02 juin
Après avoir vu Lovely Runner (qui n’a aucun rapport avec la course, qu’on se le dise), je suis revenu à Doctor Slump, dont j’avais vu le premier épisode plus tôt dans la semaine, sans être convaincu.
Les séries coréennes, avec leurs seize épisodes de plus d’une heure, se vivent comme des marathons… et comme je suis impatient, je les regarde d’affilée, à toute vitesse. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment l’arc narratif se développe. Un visionnage fragmenté (en regardant un épisode par jour, par exemple) ne me permettrait pas d’avoir cette vision d’ensemble.
Très souvent, la fin des romances coréennes me frustre, car elles succombent à la malédiction de la séparation des amants, un trope-cliché devenu malheureusement incontournable.
Et c’est sur ce point que Lovely Runner m’a surpris : le dernier épisode est entièrement dédié à la romance des protagonistes. Un épisode entier ! De l’inédit ! Jusqu’à la fin, j’ai cru que le méchant allait revenir… ce qui ne m’a pas permis de me détendre et de profiter, comme il fallait, de ces scènes charmantes.
Lundi 03 juin
Je regarde à nouveau Lost Romance, une série taïwanaise de vingt épisodes (1 h 10 chacun), où la protagoniste se retrouve projetée dans une romance. Éditrice et fine connaisseuse du genre, elle décide de séduire l’overbearing CEO en utilisant sa connaissance des tropes romantiques.
C’est exactement ce que j’aimerais écrire : un roman qui est en même temps un commentaire du genre auquel il appartient. Une romance sur l’univers des romances !
Pour relier cette entrée à celle de vendredi dernier, Lost Romance appartient certainement au genre de l’isekai.
Mardi 04 juin
« Les rêves ne sont pas des inventions intentionnelles et volontaires, mais au contraire des phénomènes naturels et qui ne diffèrent pas de ce qu’ils représentent. Ils n’illusionnent pas, ne mentent pas, ne déforment ni ne maquillent ; au contraire, ils annoncent naïvement ce qu’ils sont et ce qu’ils pensent. Ils ne sont agaçants et trompeurs que parce que nous ne les comprenons pas. […] L’expérience montre […] qu’ils s’efforcent toujours d’exprimer quelque chose que le moi ne sait et ne comprend pas. » (C.G. Jung, Psychologie et éducation)
Mercredi 05 juin
De Jung, j’aime son travail sur les symboles, les mythes et les archétypes. Je le préfère à Freud, qui ne m’a jamais emballé. (Trop paternaliste, certainement.)
Un écrivain ne peut qu’être séduit par les recherches de Jung : après tout, la littérature se nourrit elle aussi de cette matière mythique et symbolique.
La seconde partie du livre de Frédéric Lenoir est consacrée à l’exposé de ses idées (anima/animus, synchronicité, persona, le Soi, etc.). Je m’aperçois que j'ai aimé davantage la première partie qui était biographique. Les deux sont bien écrites, dans une langue simple et claire, mais une biographie me parle plus que des définitions et des concepts.
J’ai un gout certain pour la réflexion, comme en témoigne ce journal, mais assez peu finalement pour la théorie, surtout si elle m’apparait déconnectée de la (/ma) réalité. J’éprouve le même ennui que lorsque je lis un texte sur le stoïcisme qui s’efforce d’exposer ce qui en relève et ce qui n’en relève pas. J’aime la philosophie pratique, car elle nous enseigne comment mieux vivre ; je n’aime pas quand la recherche de la sagesse s’enferme dans sa tour d’ivoire.
Jeudi 06 juin
Chaque semaine, invariablement, la newsletter de Courtney Milan me parle. Je n’ai jamais lu ses romans, mais ce qu’elle raconte dans son Weekly Tea semble trouver un écho en moi. J’apprécie cette résonance. Nous avons peut-être une personnalité similaire ; je ne peux pas le savoir : elle vit à l’autre bout du monde.
Aujourd’hui, grâce à elle, j’ai médité sur la place de l’amour inconditionnel dans ma vie. C’est un concept d’autant plus intéressant qu’il m’est étranger. L’homo que je suis ne semble connaitre que l’amour conditionnel : je dois me comporter de telle ou telle sorte pour que la société me tolère (ou m’aime). Même quand je m’émancipe de l’hétéronorme, je ne me débarrasse pas facilement de la vision du monde (et de moi) que j’ai construite sous son joug.
Vivre l’amour inconditionnel, c’est faire l’expérience dans sa chair, dans ses os (et pas seulement en théorie), d’une vérité tellement simple qu’elle en apparait révolutionnaire : être au monde, tel que l’on est, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, est suffisant pour mériter l’amour, non seulement des autres, mais surtout de soi.
Vendredi 07 juin
« Plus la raison critique prédomine, plus la vie s’appauvrit ; mais plus nous sommes aptes à rendre conscient ce qui est inconscient et ce qui est mythe, plus est grande la quantité de vie que nous intégrons. La surestimation de la raison a ceci de commun avec un pouvoir d’état absolu : sous sa domination, l’individu dépérit. » (C.G. Jung, L’Homme et ses symboles)
Samedi 08 juin
Ces dernières années, les œuvres qui m’ont inspiré sont principalement audiovisuelles. C’est encore le cas avec The Atypical Family (sur Netflix). Le scénario est extrêmement bien mené et les personnages attachants. Que demander de plus ? Une version gay, évidemment.
Je passe une grande partie de mon temps à me demander comment traduire de telles histoires.
Traduire… Non pas au sens linguistique, mais aux sens générique et social. Comment passe-t-on de l’écran à la page ? Quels sont les éléments qui doivent changer et ceux qui peuvent rester tels quels afin de produire un effet similaire ?
Mais aussi : comment passe-t-on d’une histoire hétéronormée asiatique à une romance homosexuelle occidentale ? (Il ne me viendrait jamais à l’idée d’écrire un roman qui se passe en Asie si je n’y vivais pas moi-même.) En particulier, que faire des tropes du mariage dans une histoire gay ?
Si j’effectuais toutes ces modifications, est-ce que l’histoire me plairait autant ? Devinerait-on encore la version originale ?
Dimanche 09 juin
Peu importe si l’idée est extravagante ou ridicule à première vue, l’essentiel est de la rendre crédible. L’exécution est donc ce qui importe le plus. La lectrice acceptera l’impossible ou l’improbable tant que l’histoire est bien faite et que tous les éléments du récit vont dans le même sens. C’est ainsi que l’on crée la vraisemblance.
Est vraisemblable ce qui est crédible à l’intérieur du récit. Si le lecteur accepte de suspendre son incrédulité, c’est parce que l’autrice promet une histoire logique qui fait sens…
Dans certains genres (comme la SFFF), cette logique est interne : une école de sorciers dans un Archipel où existent des dragons est vraisemblable seulement si les règles de ce monde (càd le worldbuilding) le permettent. Savoir si une telle école existe dans notre réalité est sans importance : Terremer n'en est pas moins crédible aux yeux du lecteur.
L'erreur, me semble-t-il, c'est de croire que la vraisemblance naît d'une reproduction servile du réel.
Lundi 10 juin
Je lis Our Radiant Ambers, le premier roman de fantasy urbaine romantique de Zarah Detand. C’est très bien fait. Je retrouve ce que j’ai aimé dans ses romances MM précédentes : l’attention du détail, les dialogues pleins d’esprit, des personnages attachants, etc. Les éléments de fantasy, bien qu’essentiels à l’intrigue, n’encombrent pas la lecture : c’est parfait pour les lectrices qui n’aiment pas trop s’aventurer en dehors des romances réalistes.
Mardi 11 juin
Dans Our Radiant Ambers, la rupture amoureuse (ou plutôt le moment où la séparation des amants prend fin) est maladroite : le protagoniste s’effraye à la suite d’un incident prévisible, quitte celui qu’il aime, puis, une semaine plus tard, s’effraye à nouveau quand ce dernier s’évanouit ; il décide alors qu’il n’aurait pas dû le quitter et retourne auprès de son amant, penaud.
Dans la vraie vie, ce genre de retournement arrive tout le temps. On rompt, on regrette, on essaye de se faire pardonner. Dans une romance, on attend quelque chose de plus original. Si l’intrigue fantastique fournit le motif de la rupture, il est préférable qu’elle soit aussi à l’origine de ce rabibochage.
En somme, on veut du grand spectacle, car la romance ne saurait être banale dans un roman de fantasy urbaine au risque de désappointer le lecteur.
Mercredi 12 juin
Sur les réseaux sociaux, un·e auteurice s’amuse à donner à lire des passages écrits par ses soins et d’autres (ré)écrits par une IA. Il s’agit de la même scène à chaque fois : le contenu est donc relativement identique. Les extraits sont courts à dessein, car, laissée à elle-même, l’IA finit par halluciner.
Résultat : un certain nombre de lecteurices préfère ce qui est produit par l’IA, croyant que c’est l’auteurice qui l’a écrit. Moment de gêne dans les commentaires quand iels s’en aperçoivent.
Copiant le style de l’auteurice, l’IA écrit avec une plus grande élégance et une habileté plus consommée. La phrase se fait moins boursoufflée, ce qui en améliore la lecture.
Je ne sais pas si c’était ce que l’auteurice en question souhaitait démontrer. J’en doute fortement, mais j'ai apprécié cette démonstration quoi qu'il en soit.
Évidemment, la supériorité de l’IA n’est que ponctuelle. Elle sert d’assistante éditoriale, proposant des améliorations que l’auteurice peut suivre s’iel y trouve de l’intérêt.
Qui sait de quoi elle sera capable dans six mois ou un an.
Jeudi 13 juin
Le drama politique français à l’approche des élections législatives n’a rien à envier aux délires d’outre-Manche que l’on endure depuis Brexit. C’est rafraichissant.
Vendredi 14 juin
Misogynie dans les mouvements spirituels et religieux.
« Nous observons le même phénomène curieux dans les grandes religions du monde qui rejettent le féminin et révèrent le masculin. Le principe féminin a traditionnellement été rejeté, car il est perçu comme faible et inutile pour permettre un véritable progrès sur le chemin spirituel. Par exemple, (…) la discrimination, ou la capacité intuitive à distinguer le réel de l’irréel, est vue comme la principale condition pour progresser dans le Vedanta. Elle est qualifiée de trait masculin et privilégiée par rapport à la dévotion, une qualité féminine. Dans d’autres traditions, le seul progrès spirituel que les femmes peuvent espérer est de se réincarner en hommes, car on pense que seuls les hommes peuvent atteindre la libération ou l’affranchissement de la souffrance. »
(Shakti Rising: Embracing Shadow and Light on the Goddess Path to Wholeness de Kavitha M. Chinnaiyan MD, trad. DeepL & ED)
Lundi 17 juin
Lors du passage de l’analogue au numérique, je n’ai gardé que les livres. Je n’achète plus de DVD, de CD, etc. Je me suis laissé séduire par la nouvelle économie de l’abonnement (Netflix, Apple Music, etc.), même si ça veut dire que je ne possède plus rien et que, le plus souvent, je laisse aux algorithmes le soin de faire un choix à ma place.
Quant à ce que j’ai vraiment acheté en numérique, j’accepte le fait qu’un jour, je n’aurai plus accès à ces produits culturels. Amazon, Apple et compagnie peuvent changer les règles à tout moment et fermer notre compte. Ainsi soit-il.
Mardi 18 juin
La seconde partie du mois est une joie, car c’est à ce moment-là que je reçois les quatre thés de mon coffret découverte. La dernière fois, c'était un voyage sur l'île de Taïwan.
Aujourd’hui, c’est un thé vert de Huangshan (Ding Gu Da Fang), un thé noir de Qimen (Keemun Jin Zhen Golden Needle), tous les deux situés dans la province de l’Anhui, un oolong de Guangdong/Canton (Dan Cong Huang Zhi Xiang) et un thé blanc du Yunnan (Bai Ya White Bud).
Ce dernier est composé de nouvelles pousses à peine séchées ; sa liqueur est transparente. Je crois que je suis en train de développer une préférence pour les thés blancs.
Le mois prochain, nous explorerons des thés du Pacifique.
Mercredi 19 juin
Si Sheffield n’était pas situé dans une région aussi nuageuse, la vie y serait très agréable. Ce n’est pas tant les températures basses qui me gênent que cette grisaille constante, qui finit par saper le moral. Quand le soleil apparait, mon regard sur ce qui m’entoure devient plus positif. Je dois être une créature héliotrope.
Jeudi 20 juin
Je n’ai pas encore 37 ans, mais je sens la crise de la quarantaine approcher à grands pas. L’insatisfaction de ces derniers mois, généralisée à tous les aspects de ma vie, dont l’écriture (pauvre de moi !), est un signe qu’il faut changer quelque chose… Je crois deviner une direction, un futur où je serais davantage satisfait de mon existence, mais je ne veux rien brusquer.
Mes explorations du Tao m’ont enseigné qu’il ne faut pas forcer les choses : nager à contrecourant de notre existence ne fait qu’épuiser le peu d’énergie que nous avons ; il faut se laisser porter, tout en se tenant prêt à saisir l’opportunité lorsqu’elle se présentera, car elle finit toujours par se présenter (mais peut-être pas sous la forme que l’on attendait).
Vendredi 21 juin
La colère, une émotion à laquelle je me soumets rarement, est épuisante. Elle sape mes forces et finit par m’emplir de honte. Je me voudrais calme et imperturbable en toute circonstance. Mais j’ai mes limites et quand on les transgresse, il est utile de rappeler que je ne suis pas du genre à tout accepter sans mot dire. Pire peut-être, quand j’arrive au bout de ma patience, les gens découvrent, non sans une certaine stupéfaction, que je ne pardonne pas.
Samedi 22 juin
« Empire of Death », l’épisode de fin de saison de Doctor Who, est décevant (c’est un euphémisme). Il cristallise le ressenti mitigé que j’ai éprouvé durant toute la saison.
Trop souvent, Russell T Davies (un scénariste que j’admire beaucoup pourtant) a fait preuve de complaisance dans l’écriture de ses épisodes, ne se donnant pas la peine d’apporter une explication satisfaisante aux intrigues.
La relation entre le Doctor et Ruby n’est pas bien approfondie, ni développée de manière logique (les épisodes étaient-ils seulement dans le bon ordre ?), si bien que la scène de séparation entre les deux n’est pas aussi émouvante qu’elle aurait pu l’être.
Heureusement, des épisodes comme « Boom » et « Rogue » ont remonté le niveau de cette saison 14. Mais notons, comme à regret, qu’ils ont été écrits par d’autres scénaristes.
Dimanche 23 juin
Nous arrivons à la fin du mois de juin — mois durant lequel je m’étais promis de ne rien faire, car c’est l’une des périodes les plus éprouvantes au boulot.
Très bientôt donc, il va falloir repenser à l’écriture et à ces questions sans réponse qui m’ont préoccupé ces derniers mois. Ça me fatigue d’avance. Puis-je procrastiner ?
Lundi 24 juin
« Notre grande erreur est d’essayer d’obtenir de chacun en particulier les vertus qu’il n’a pas, et de négliger de cultiver celles qu’il possède. » (Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien)
Mardi 25 juin
Notre sortie à Lincoln, pour l’anniversaire de mon mari, a été l’occasion d’acheter du thé noir pu-erh (c’est-à-dire post-fermenté).
Mon abonnement découverte, dont j’ai parlé ici, a changé le regard que je porte sur le thé… et, par extension, l’avis que je me fais des boutiques qui en vendent.
Celle de Lincoln, où nous allons chaque fois, a une sélection très limitée de thés blancs (et la plupart sont parfumés, qui à la vanille, qui à l'ananas...).
Du coup, de retour à Sheffield, j’ai commandé du Bitaco White de Colombie — le même que j’avais reçu dans ma première boite découverte. 11,25 £ pour 50 grammes — ça reste abordable, même si ce n’est pas donné. C’est vrai que le thé blanc est généralement plus cher que le noir ou le vert, puisque seules les jeunes pousses sont récoltées.
Mercredi 26 juin
Je viens de reprendre ma lecture de Pair de l’Empire (Servent of the Empire) de Feist et Wurst, toujours en traduction française. C’est un peu longuet, mais le récit est plaisant.
J’ai tellement lu de mauvaises traductions de l’anglais (merci la romance MM) que je ne cesse d’être surpris par l’excellente qualité, la bonne tenue, de la langue d’Anne Vétillard. Je suis admiratif de son travail.
(Et en rédigeant cette entrée, je découvre qu’elle est morte le 1er avril dernier à l’âge de soixante ans. Quelle mauvaise blague.)
Jeudi 27 juin
Les joies algorithmiques.
En ce moment, Twitter, c’est un tiers élections françaises, un tiers élections anglaises et un tiers sur les séries Boys' love.
Threads, c’est presque 100 % des posts d’auteurs anglophones et francophones, et c’est insupportable. Ça chouine de tous les côtés. Look at me, look at me, why don’t you look at me?!
Et quand ça ne chouine pas, ça s’enrage (parfois à raison, parfois par simple habitude).
Bien sûr, je m’inclus dans ce constat, car je ne fais pas exception. Ce qui ne fait que m’agacer davantage.
Vendredi 28 juin
Faire des lecteurs les responsables du gatekeeping (c.-à-d. chargés de faire le tri), quand ce rôle a été longtemps tenu par les éditeurices, ne me semble pas être une amélioration, mais une manifestation supplémentaire de l’emmerdification de notre quotidien.
C’est vrai que l’autoédition a permis l’émergence de voix minorisées sur le marché du livre. De nos jours, il est possible de lire des romans qui n’auraient jamais été édités, car on ne pensait pas qu’ils étaient « commercialement viables ». La plus-value est incontestable, même si le travail éditorial, à l’occasion, peut laisser à désirer.
Il serait donc facile de désigner les pauvres auteurs autoédités comme les responsables de cette emmerdification, puisque tout est devenu publiable par n’importe qui.
Mais la saturation du marché du livre s’explique surtout par les choix commerciaux des maisons d’édition qui ont multiplié leurs publications, souvent sans égard pour la qualité finale. Quand un livre n’a que deux semaines pour faire ses preuves avant de finir au pilon, importe-t-il vraiment encore de veiller à ce que son histoire tienne la route, qu’elle soit bien écrite et parfaitement corrigée ?
Samedi 29 juin
Le milieu de Pair de l’Empire m’a fait passer une excellente soirée de lecture : même si les descriptions sont un peu trop longues à mon gout (et j’ai donc lu certains paragraphes en diagonale), les évènements sont passionnants. Il y a une véritable intensité : on tourne la page, on se couche tard pour connaitre la suite.
Je réalise à quel point les romans avec des intrigues politiques sont ma came, surtout si elles sont (un peu) violentes. (J’avais dévoré Imperium de Robert Harris dont l’histoire est centrée sur Cicéron.)
Comme toujours, ce genre de coups de cœur littéraire alimente mes envies d’écriture…
Dimanche 30 juin
En ce moment, écrire ce journal me donne l’impression de gratter les fonds de pots à la recherche d’une once d’inspiration.