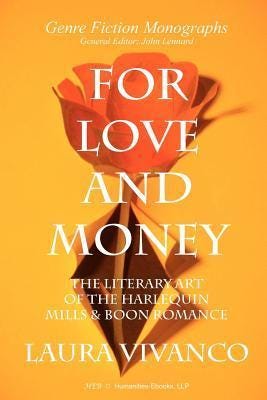La version intégrale de ce journal est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.
J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.
So long!
Enzo
Samedi 01 février
N’oublions jamais que, comme dit la blague, pendant que les gays étaient occupés à baiser dans les buissons, les lesbiennes, elles, parlaient politique et ourdissaient la reconnaissance de nos droits les plus fondamentaux.
Dimanche 02 février
Jeanne (S.J. Hayes/la Fée éditoriale) vient de me conseiller le livre de Laura Vivanco, For Love and Money: The Literary Art of the Harlequin Mills & Boon Romance (2011), que je vais m’empresser d’acheter.
Je crois que mon entrée dans le monde de la romance s’est faite en 2011, justement, lorsque j’ai assisté en compagnie d'une ancienne amie de fac à une avant-première à Hammersmith (Londres) du documentaire True Stories: Guilty Pleasures de Julie Moggan. Je me rappelle avoir été fasciné, en particulier par Roger qui écrivait des romances médicales sous pseudos féminins dans une caravane du Lake District.
Je connaissais la marque éditoriale Harlequin, bien évidemment, car nous avions aussi cet éditeur en France, mais je n’avais jamais entendu parler de Mills & Boon… Deux ans plus tard, je découvrirais la romance MM grâce à Dreamspinner Press. Je travaillerais même pour eux… and the rest is History, comme on dit.
Mercredi 05 février
2025 va donc prendre une direction inattendue pour moi. Il va me falloir faire le deuil d’une relation de douze ans… Je ne suis pas sûr d’être prêt à faire face aux hauts et aux bas qui m’attendent, ni aux choix sans fin qu’il va falloir faire (dans mon cas particulier : est-ce que je reste en Angleterre ? Pour combien de temps ?). Mais on n’obtient pas toujours ce que l’on veut dans la vie.
Aussi : que va-t-il arriver de mon amour des romances ? Vont-elles soudainement m’insupporter ? Stay tuned.
Jeudi 06 février
Cette semaine, Courtney Milan, tout en décrivant la situation horrifique qui se développe aux États-Unis, se refuse d’être alarmiste.
« Lorsque notre cerveau est en mode “survie”, nos impulsions de lutte ou de fuite sont stimulées, et c’est à ce moment-là que nous sommes le plus susceptibles de commettre des erreurs et de faire des choses horribles. L’objectif des fascistes est d’activer cette réponse automatique en nous, de faire en sorte que nous divisions les gens en deux catégories : “ennemis à détruire” ou “alliés dans la lutte pour détruire les ennemis”. (…)
C’est notre “cerveau social” qui nous fait travailler ensemble. C’est ce qui nous pousse à sauver des vies, à être solidaires et à travailler pour une cause commune. C’est ce qui nous permet de nous améliorer en tant qu’espèce.
Je pense qu’il est extrêmement important pour nous de conserver autant que possible notre cerveau social : nous connecter avec d’autres êtres humains et les aider, plutôt que de passer notre temps à nous battre. »
En somme, être alarmiste, c’est activer le mode « survie » de notre cerveau (et de celui des autres !) qui court-circuite les bienfaits de notre « cerveau social ».
Vendredi 07 février
Amusant (ou pas) comme les insécurités que j’avais il y a douze ans sont remontées à la surface aussitôt qu’il a été clair que mon mariage venait de prendre fin. Évidemment, ces angoisses ne sont pas rationnelles (existe-t-il seulement des angoisses rationnelles ?)… et il ne faut donc pas s’identifier à elles. Je ne suis pas ces émotions, même si elles font partie de moi.
Même quand on est sous leur emprise et qu’on ne peut pas leur échapper, il est bon de savoir que, telle la marée, elles finiront par se retirer, à moins qu’on ne les nourrisse chaque jour davantage.
J’essaye donc de les observer, curieux, un peu comme si je méditais, sans les rejeter pour autant… Même les parasites ont un rôle utile à jouer. Et je dois prêter l’oreille à ce qu’elles disent, même s’il ne faut pas prendre ces drama queens au pied de la lettre.
Ces premiers épisodes de panique m’ont rappelé le besoin de me remettre à la méditation : je n’échapperai pas à la douleur, mon deuil se fera en temps voulu, mais je veux garder l’esprit assez clair pour prendre de bonnes décisions et ne pas tout envoyer valser.
Samedi 08 février
En ce moment, la tension entre les États-Unis et le Canada prend des proportions clownesques sur les réseaux sociaux. Les Américains pensent qu’ils ont la plus grosse (masse terrestre) et qu’ils sont les meilleurs du monde (leur petit égo national a besoin d’être constamment rassuré, à l’image de celui de Trump et de Musk).
Curieux, je suis allé faire un tour sur l’Encyclopédie Britannica en ligne (je sais, je suis un écrivain subversif)…
Et voici les pays du monde qui ont la plus grosse, dans l’ordre : la Russie (17 075 400 km²), le Canada (9 984 670 km²), les États-Unis (9 834 633 km²), la Chine (9 572 900 km²), le Brésil (8 502 728 km²). Les cinq suivants sont : l’Australie, l’Inde, l’Argentine, le Kazakhstan et l’Algérie.
Évidemment, nous savons tous que ce n’est pas la taille qui compte… mais quand on observe les États-Unis, on ne peut pas dire qu’ils soient particulièrement doués non plus.
Dimanche 09 février
« Pourquoi publions-nous nos commentaires sur des réseaux sociaux plutôt que sur nos sites personnels ? Par commodité et dans l’espoir de retrouver nos « amis ». Nous finissons par avaler une montagne de contenus indésirables placés sous nos yeux par des algorithmes pour nous maintenir sur la plateforme et consommer des publicités.
Ces contenus indésirables altèrent notre imaginaire, notre philosophie, notre conception du monde, d’autant plus qu’ils proviennent prétendument de nos « amis ». Un réseau social algorithmique n’a rien de social : c’est une machine à nous emprisonner. On ne peut s’y aventurer qu’en pleine conscience des dangers encourus. » (Thierry Crouzet, Le prix de la liberté numérique, 9 février 2025)
Mardi 11 février
En affirmant que l’IA démocratise l’écriture et permet à tout le monde de pondre un roman en quelques heures, ses évangélistes ne comprennent rien à l’art d’écrire de la fiction, et plus généralement à la création artistique.
Certes, nous nous plaignons constamment : écrire, c’est dur ; les belles phrases ne viennent pas spontanément ; telle scène manque d’émotion, telle autre de fluidité. Nous procrastinons ; nous avons même peur d’une page blanche ! Mais pourquoi revenons-nous à l’écriture même quand celle-ci est difficile et que celles et ceux qui veulent en vivre se condamnent le plus souvent à l’indigence ? La création artistique répond à un besoin profond en nous ; le satisfaire, même dans l’inconfort, donne du sens à notre vie. L’artiste crée.
Les LLMs retirent l’humain de la création. Les auteurices deviennent des prompteurs, des donneurs d’instructions ; le reste est fait par des petites mains virtuelles. Les choix difficiles sont sous-traités. Tout se passe désormais en dehors de notre psyché. Notre jardin intérieur s’appauvrit. Pourquoi voudrait-on se saborder ainsi ?
Mercredi 12 février
« Quand on vit des crises, et nous en vivons une, d’abord initiée par la TV, puis les réseaux sociaux, maintenant amplifiée par les IA, nous avons tendance à dramatiser, à croire que nous ne nous en relèverons pas, que la littérature ne s’en relèvera pas. Et nous tentons de noter tant que c’est encore possible, nous disant que peut-être c’est pour la dernière fois. En vérité, toute cette écriture, tout ce jaillissement de mots, dit que la littérature, peu importe ce qu’elle est, continue de vivre, et continuera de vivre d’une façon ou d’une autre, au moins quelque temps. La crise fait de nous des écrivains notables. Et ceux qui ne perçoivent pas la crise naviguent heureux hors de la littérature. La littérature n’est peut-être qu’une succession de crises. » (Thierry Crouzet, Carnet, Janvier 2025)
Vendredi 14 février
Je trouve les tropes de la romance fascinants. Pouvoir tout étiqueter, quel pied ! J'ai l'impression d'être un entomologiste littéraire.
Mais quand un genre se réduit à une liste d’ingrédients, et que le discours sur la création littéraire se limite à ces seuls lieux communs, on perd de vue l’intérêt de la littérature et on la réduit à une pratique commerciale. À mes yeux, il ne fait aucun doute que la romance appartient à la littérature, que l’on mette à cette dernière une majuscule ou non. Je ne considère pas qu’écrire des romans qui vendent soit honteux ni que ce soit facile. Parler technique n’avilit pas la littérature, c’est même nécessaire : nous sommes autant artistes qu’artisans.
Mais la romance ne peut s’épanouir en vase clos ; les auteurices ont besoin d’aller voir ailleurs pour l’enrichir. On peut être littérature doudou, réconforter le cœur des lecteurices, en éprouver de la fierté, sans pour autant proposer une création insipide sans ambition. Je regrette cette complaisance et ce manque d’exigence que je discerne parfois dans notre petit milieu.
Samedi 15 février
On ne respecte pas autrui et ses différences quand on se lance dans un sermon.
Notre civilisation occidentale, qui pratique le prêche depuis un ou deux millénaires, ne connait pas d’autres modes de communication : nous partons du principe que nous sommes meilleurs que les autres nations, qu’il existe un exceptionnalisme occidental (on l’appelle parfois le « progrès »). Nous jugeons constamment. Nos valeurs sont les plus nobles : le monde — ces sauvages ! — doit être à notre image. Nous nous parons des oripeaux de la Civilisation (avec une majuscule, excusez du peu) et nous apportons ses lumières sur tous les continents.
En réalité, nous avons encore une disposition d’esprit paternaliste et colonialiste. Nous ne dialoguons pas : nous parlons, ils doivent écouter. Nous savons mieux qu’eux l’aide dont ils ont besoin. We know better.
En France, Macron incarne parfaitement cela : ses allocutions jupitériennes au Journal de 20 Heures, ses remarques en Afrique, ses échanges avec les Mahorais·es. Quand cette morgue méprisable éclate au grand jour, n’y voyons pas une bévue ; c’est un symptôme du virus qui gangrène notre esprit occidental. Même les plus « éclairé·es » d’entre nous succombent à ce mal. Et ce virus nous empêche de débattre calmement de l’immigration, par exemple, ou de l’assimilation. (Ou pour citer un débat bien franchouillard : du voile…)
Comme nous refusons de nous mettre à la place d’autrui, nous sommes choqués de découvrir l’animosité, la rancune ou la colère que l’on suscite chez celles et ceux que nous « aidons » (ou avons aidé).
Dans le monde multipolaire qui est en train d’émerger, il est vital que nous changions notre disposition d’esprit. Le remède est simple (mais amer et difficile à avaler, j'en conviens) : descendre de notre piédestal, nous regarder dans un miroir et accepter l’idée que nous puissions être dans l’erreur.
Dimanche 16 février
Alors que la fin de ThamePo approche inexorablement, la Thaïlande offre déjà une autre série phénomène pour piquer l’enthousiasme de notre communauté.
L’équipe derrière I Told Sunset About You, une des séries BL les plus mémorables de 2020, a quitté les paysages idylliques de Phuket pour la jungle urbaine de Bangkok, et en particulier de Siam, l’un des quartiers les plus connus et les plus populaires de la capitale. Gelboys, c’est le tableau hyperréaliste des us et coutumes de la génération Z, de ces lycéens thaïlandais branchés qui vivent leurs premiers émois amoureux.
Si ThamePo donne à voir un traitement doux et rassurant de son sujet, Gelboys se situe à l’opposé : il s’agit d’un instantané. Rien n’est gommé. On a l’impression d’y être. Bienvenue à Bangkok, avec sa foule, sa cacophonie, sa chaleur, son BTS. Il ne manque plus que les odeurs !
Cette approche mimétique crue, si rare dans les séries BL, m’oblige d’ailleurs à me poser cette question : est-on seulement dans un Boys Love (où le couple de protagonistes est toujours garanti d’avoir une fin heureuse) ? Ou s’agit-il d’une tranche de vie, semblable à un roman initiatique queer, ce qui autoriserait une fin ouverte et donc moins facilement prédictible ? On le saura à la fin du septième épisode.
Mardi 18 février
D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours trouvé difficile d’écrire de manière neutre, de rapporter les arguments d’autrui ou d’expliquer des concepts. Quand je m’y essaye, je me sens maladroit. La tâche m’apparait vite fastidieuse — et c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles je procrastine autant quand je veux écrire de la non-fiction.
J’écris des histoires depuis l’adolescence. Le « je » et la subjectivité sont au centre de mes préoccupations. En tant qu’écrivain, rapporter des faits, rien que des faits, ça ne m’intéresse pas. Je ne pourrais pas être journaliste, mais j’admire ces mercenaires du verbe qui écrivent avec aisance et clarté.
Développer un argument avec élégance, tout en attisant l’intérêt de son lectorat, est un art. L’effort pour y arriver m’apparait parfois insurmontable.
Jeudi 20 février
L’intérêt d’être fan d’une série, c’est que ça permet de dater le moment exact où l’on a appris un fait.
C’était donc en 2008, en regardant un épisode de Doctor Who (saison 4), que j’ai appris qu’Agatha Christie avait disparu de la surface du monde pendant plusieurs jours avant de réapparaitre à une heure de chez moi, à Harrogate dans le Yorkshire, et que la raison de sa disparition demeurait inexpliquée jusqu’à nos jours. « The Unicorn and the Wasp » se proposait de boucher les trous, de manière très divertissante, avec le Doctor, Donna et une fameuse cabine téléphonique bleue…
Il a donc fallu attendre ce jour de février 2025, grâce à la newsletter de Lucy Worsley, pour que j’apprenne que cette anecdote biographique n’était en rien énigmatique (malgré ce que l’on a affirmé pendant des décennies).
Alors, que lui est-il arrivé vraiment ? En décembre 1926, Christie, en pleine dépression suite aux infidélités répétées de son époux, attente à sa vie. Ce choc la fait basculer dans un état de « fugue dissociative », où la malade abandonne sa fille, oublie son passé et adopte une nouvelle identité… Elle reviendra à elle onze jours plus tard à l’autre bout du pays.
Comment le sait-on ? C’est l’autrice elle-même qui l’explique dans une longue interview de 1928… mais n’oublions pas qu’elle vit à une époque misogyne où l’on prend facilement ombrage du succès commercial étourdissant d’une femme. On préfère donc ne pas la croire et s’accrocher à des motifs plus sinistres… selon lesquels, par exemple, elle aurait été une manipulatrice perverse en quête d’attention pour gonfler ses ventes.
Je me dis que les temps n’ont pas vraiment changé. The Daily Mail, à qui elle avait accordé cet entretien il y a presque un siècle, est un torchon qui continue de s’attaquer aux femmes (Meghan Markle étant la plus connue).
Et je ne parle même pas de la vox populi, vox diaboli que sont les réseaux sociaux, où les femmes célèbres sont accablées d'injures et harcelées quotidiennement.
Vendredi 21 février
Pour la première fois depuis une éternité, nous sommes allés au centre-ville afin de faire quelques emplettes. Comme j’avais besoin de réconfort, et que la présence des livres suscite invariablement en moi une vague de bienêtre, nous sommes allés boire un thé à la librairie Waterstones.
Les livres me grisent. Il n’y a pas d’autres mots. Ancrée profondément en moi, il y a cette croyance que ce petit objet, modeste en apparence, peut me sauver de la morne réalité et révolutionner mon existence. Les librairies ou les bibliothèques sont, à mes yeux, le terrain de jeu de la sérendipité.
J’ai fait deux achats, au final : The Science of Meditation (2017), de Daniel Goleman & Richard J. Davidson, et Languages of Truth: Essays 2003-2020 de Salman Rushdie.
Le premier répond à des questionnements que j’ai sur le sujet depuis quelques années… et qui sont revenus, vivifiés, sur le devant de ma scène mentale ces derniers jours (j’ai écouté plusieurs podcasts sur le bouddhisme et la méditation).
Quant au second… j’aime Rushdie, le romancier et le conteur, sans qu’il ne siège pour autant au faite de mon panthéon littéraire. Mais, dès qu’elle se présente, je saisis l’occasion de découvrir les essais de celle et ceux dont j’ai aimé les romans. Peut-être que je serai déçu. Peut-être que j’aurai une nouvelle révélation. Nous verrons bien.
Samedi 22 février
Absurde, cette pratique marketing qui consiste à mettre des citations de gens célèbres sur la couverture, en croyant qu’elles feront vendre.
Sur celle du recueil de Rushdie, on peut lire : « Un des plus grands écrivains de notre temps »… par un certain Neil Gaiman. Oups. Gageons qu’elle sera retirée au prochain tirage.
Dimanche 23 février
Toutes les méditations ne se valent pas. J’emploie le pluriel, car il n’existe pas une seule technique de méditation, contrairement à ce que le public croit, mais des dizaines, voire des centaines… Très souvent, quand on parle de « méditation », on fait référence à la méditation de pleine conscience (mindfulness).
Il semblerait que celle qui réarrange les circuits neuronaux de manière durable et le plus rapidement soit celle que l’on appelle « loving-kindness », c’est-à-dire une méditation sur « l’amour bienveillant » (maitrī en sanscrit ou mettā en pāli), qui permet de développer sa compassion non seulement envers les autres, mais aussi soi-même. Il suffirait de huit heures à peine pour voir les premiers effets (passer à l’acte pour aider un étranger dans le besoin) et de seize heures pour réduire ses préjugés inconscients (unconscious bias). (Exemple de préjugés inconscients : ce qui est attaché au féminin ou à la couleur noire est perçu comme étant négatif ou inférieur.)
Pour les pratiques de mindfulness, les effets sont en général temporaires. Il faut méditer intensément et pendant des années pour que le cerveau se mette à fonctionner différemment de manière permanente.
À l’heure où l’extrême droite réacquiert pignon sur rue et est accueillie dans les hauts lieux du pouvoir les bras ouverts, peut-être que l’introduction de techniques méditatives sur « l’amour bienveillant » serait un antidote plus efficace et plus rapide que l’appel à la raison (qui ne sert absolument à rien comme nous avons pu tous en faire l’expérience sur les réseaux sociaux ou dans les repas de famille).
Lundi 24 février
« En religion et en politique, les croyances et les convictions des gens sont presque toujours obtenues de seconde main, sans examen, par des autorités qui n’ont pas elles-mêmes examiné ces questions, mais qui les ont hérité d’autres personnes, dont les opinions à ce sujet ne valaient pas un sou. » (Mark Twain)
Jeudi 27 février
Au sujet de la trilogie de Gormenghast :
« À ce stade, je me représente Peake en train de s’exaspérer. “Vous n’avez rien compris”, dit-il dans ma tête. Et je ressens un soulagement intense. Vous ne comprenez pas. Nous ne pouvons pas, absolument pas, exiger que chaque œuvre de genre soit un récit d’aventure avec une intrigue et des enjeux qui bouleversent le monde, comme dans ces romans qui envahissent nos étagères contemporaines. En fait, on ne peut même pas s’attendre à ce que l’auteur établisse constamment des relations de cause à effet, ce que nous appelons l’intrigue. Parfois, les choses arrivent sans raison. Peut-être que les évènements sont simplement beaux et dénués de sens, ou beaux et pleins de sens, et que nous, lecteurs, pouvons soit nous assoir en leur compagnie, les accepter tels qu’ils sont et nous permettre de ressentir de la joie devant la beauté, soit poser le livre et aller lire une histoire où les enjeux sont clairement indiqués dès la deuxième page, comme Save the Cat [de Blake Snyder] nous dit de le faire. »
Premee Mohamed, « The Great Intangibles of Mervyn Peake’s Gormenghast Series », sur Reactor Mag
Vendredi 28 février
Le journal d’un écrivain n’a pas pour fonction principale de commenter l’Histoire en train de se faire.
Quand cet objet littéraire ne sert pas (ou sert mal) de témoin aux hauts faits, il n’est pas rare de voir certains préfaciers déplorer, parfois durement, l’égocentrisme (ou le narcissisme !) du diariste, comme si ne pas gloser durant des pages et des pages sur la guerre en cours était la preuve d’un terrible défaut moral.
Ne pas parler d’un fait, même majeur, ne veut pas dire qu’on ignore son existence ou qu’on ne le juge pas important : on décide juste de parler d’autre chose. Le quotidien ne cesse pas d’exister parce qu’il y a la guerre : les gens mangent, boivent, se disputent et font l’amour. La joie s’invite aussi dans les plus grands malheurs. Croire que tout était sombre dans les périodes les plus sombres de l’Histoire, c’est faire preuve de naïveté. Critiquer celles et ceux qui ont voulu s'attacher à une semblance de normalité, c'est raisonner comme un tambour.