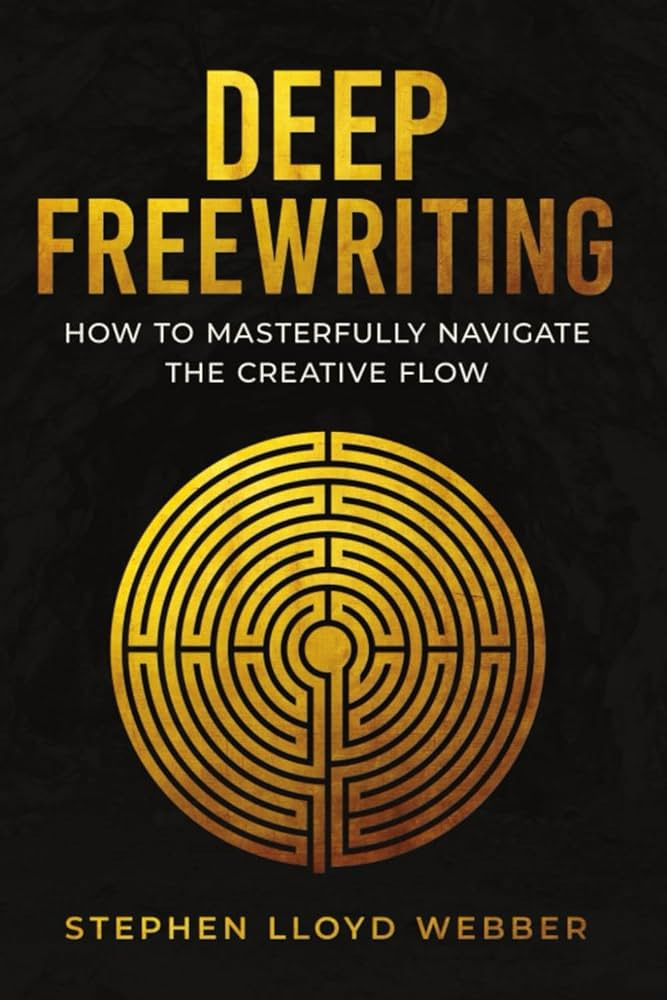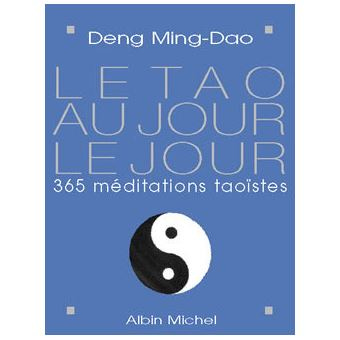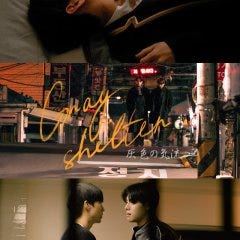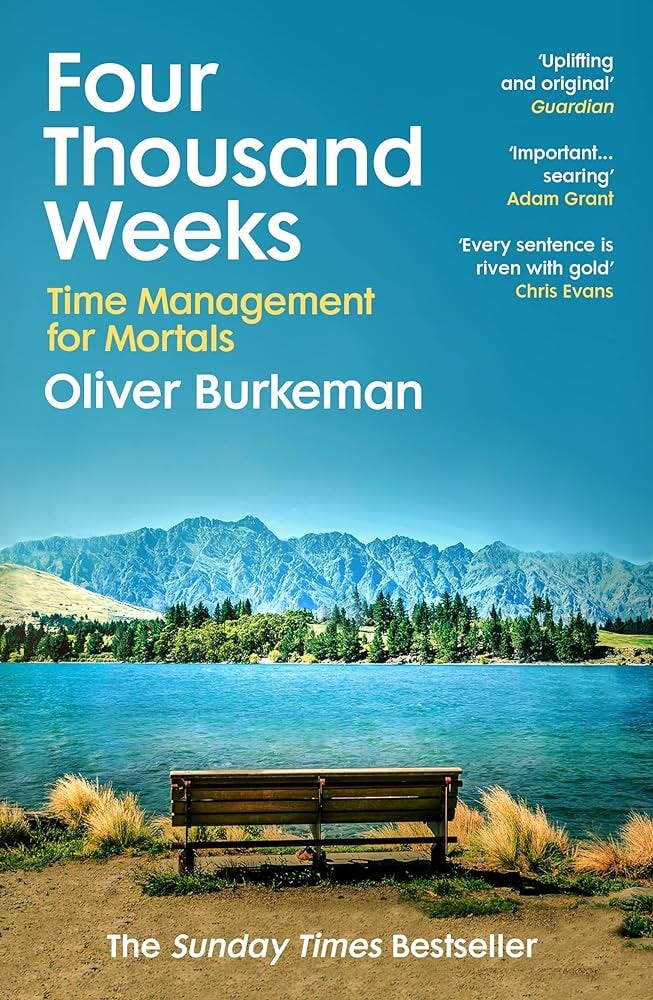Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.
La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.
J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.
So long!
Enzo
Mardi 16 avril
« Manifestement, [les best-sellers français] semblent affectés par un épuisement générique. Il n’y a pas de “roman policier”, de “roman historique”, de “roman sentimental” mais des hybrides ou des dérivations plus ou moins bien définis : des romans d’idées historiques, des thrillers émotionnels, du fantastique ancré dans la banalité ordinaire. Et, hybride des hybrides, il existerait même un “best-seller total” qui (…) s’inscrirait à équidistance des autres ensembles. »
(Pierre-Carl Langlais, "Les algorithmes rêvent-ils de best-sellers ?")
Mercredi 17 avril
Pour éviter les écueils du perfectionnisme, et les souffrances qui en découlent, beaucoup d’auteurices conseillent d’avoir des sessions de création pure, sans jugement aucun, suivies par des moments de relecture et de révisions critiques.
Les anglophones appellent les premières freewriting, souvent utilisées lors des séances de brainstorming. Elles permettent d’avoir un rapport plus sain avec l’acte d’écrire en le dédramatisant. C’est aussi le rôle des morning pages de Julia Cameron : débloquer le flot de la créativité en demandant au critique intérieur de se la fermer (pendant un temps défini).
Dans Deep Freewriting, Stephen Lloyd Webber pousse le concept plus loin encore. Il l’applique aux autres étapes de l’écriture : pour savoir comment on écrit une scène, il conseille de réfléchir sur la page même plutôt que dans notre cerveau ; en somme, de commencer à écrire avant d’être prêt et de ne pas s’arrêter à la moindre hésitation. Pas le bon mot ? Tant pis, continue. Cette phrase ne veut rien dire ? Tant pis, continue.
Une telle technique implique beaucoup de déchets : elle est à l’opposé de ce que je fais habituellement. Mais si elle m’intrigue, c’est parce qu’elle promet un rapport plus joyeux à l’écriture : si ce que j’écris n’a pas besoin d’être parfait, je peux me mettre devant l’ordinateur sans crainte… et ne pas procrastiner pendant des mois « parce que je ne suis pas prêt » (spoiler alert: je ne le suis jamais).
Je pars du principe qu’en tant que créatifs, nous ne devrions pas nourrir nos démons, ces tendances délétères et autoflagellatrices : les méthodes qui marchent pour nous ne sont pas nécessairement saines sur le long terme. Certaines conduisent droit au burnout ou à l'angoisse de la page blanche. Parfois, il faut avoir l’honnêteté de reconnaitre que si ça nous rend malheureux, c’est peut-être parce que notre méthode, qui répond certes à nos envies, n’est pas la plus adaptée à nos besoins.
Jeudi 18 avril
Dans cet article du magazine de SFFF Reactor (anciennement Tor.com), James Davis Nicoll rappelle que les « mauvais » livres, ceux à la qualité discutable (du moins, selon les critères du « bon gout » littéraire), n’en sont pas moins nécessaires à notre bienêtre. Ils répondent à un besoin que nous ne savions pas avoir.
Vendredi 19 avril
Pour écrire un roman, ce n’est pas du temps qu’il faut (disons : on peut toujours en trouver), mais de l’espace mental. C’est ce que les anglophones nomment « bandwith » (bande passante ou débit) : quand on a trop de choses à gérer dans sa vie, l’esprit n’a plus l’énergie nécessaire pour réfléchir à l’histoire que l’on veut créer.
Étrangement, un roman s’écrit aussi quand on est sous la douche ou quand on fait la vaisselle. On n’a pas besoin d’être devant son clavier ou sa feuille de papier pour l’avancer. Il faut juste que l’esprit soit libre d’associer des idées entre elles pendant que le corps, en pilote automatique, accomplit les tâches du quotidien.
Si le cerveau est obsédé par le dernier drame familial ou stressé par le boulot, il ne peut pas gérer la complexité d’un roman. Ses priorités sont ailleurs.
Samedi 20 avril
Je suis un jongleur. Passent entre mes mains de nombreuses balles… et plus les semaines passent, plus la vie m’en lance de nouvelles, que j’attrape au vol avec grâce et efficacité. Très vite, je remarque que j’ai beaucoup trop de balles en l’air. Il me faudrait une troisième, voire une quatrième, main pour les relancer toutes. Je vais devoir faire un choix ; certaines sont condamnées à s’écraser au sol. Que faire ?
Dans la vie, les balles sont de deux types : en plastique ou en verre. Dans le premier cas, si elles tombent, elles rebondissent ; dans le second, elles se fracassent. Si la balle est intacte, je peux espérer continuer de jongler avec elle dès que mes mains seront moins occupées. Dans le cas contraire, elle va direct à la poubelle : l’occasion de jongler avec elle est passée pour de bon et ne se représentera plus.
L’être humain croit souvent qu’une balle est en verre, alors qu’elle n’est qu’en plastique… et inversement. Ce comportement absurde peut être comique à l’occasion (je pense, en particulier, à la scène de la cuisine dans Mon oncle de Jacques Tati), mais les conséquences sont plus graves quand elles affectent les gens que l’on aime et qui comptent sur nous.
La finale de la compétition de foot de Justine ou le premier ballet du petit Paul, eux, ne se représenteront plus.
Dimanche 21 avril
Les taoïstes recommandent de mettre l'esprit au régime afin d'atteindre l'acuité nécessaire pour vivre bien.
‘This Daoist art of perspective-taking – recognizing the existence of various perspectives – is called the “Illumination of the Obvious” or the attainment of ming 明 (acuity, discernment). (…) The way we reach ming is by emptying our minds and letting things go. It is by clearing the “tangled weeds” that Zhuangzi says clog the mind. Zhuangzi calls it xinzhai 心齋 (fasting of heart/mind), simply saying this: put your mind on a diet!’
(Robin R. Wang, in How to Live a Good Life: A Guide to Choosing Your Personal Philosophy)
Lundi 22 avril
Quand l’amertume remplace mon enthousiasme et que je cesse d’être généreux et compatissant envers autrui, je comprends qu’il est temps de faire une pause afin de me ressourcer. Si la pause ne suffit plus, il faut alors considérer des pâturages plus accueillants.
Inévitablement, nos valeurs sont mises à mal par l’environnement dans lequel on évolue. Au final, un choix simple s’offre à nous : soit on reste et on court le risque de renier ces valeurs qui sont si importantes à nos yeux, soit on s’en va, dans l’espoir que le changement de cadre (et de collègues !) nous permettra de préserver nos ambitions vertueuses.
Mardi 23 avril
J’adore les mélodrames, surtout quand ils sont bien faits. J’accepte volontiers de suspendre mon incrédulité le temps d’un épisode ou plusieurs (j’adore les séries coréennes over the top).
Je me demande ce qu’il faudrait faire pour écrire une romance mélodramatique qui fascine les lecteurices au lieu de les rebuter. Peut-on récupérer tous les lieux communs d’un genre, s’amuser avec, sans tomber dans les clichés les plus insupportables ? Faut-il écrire dans la veine mélodramatique avec sérieux ou avec ironie ? Comment gagne-t-on la confiance de son lectorat avec un tel projet ?
Mercredi 24 avril
« Nous devons accepter ce qui arrive (…). L’adepte du Tao garde le silence [au lieu de se plaindre] et se prépare. L’acceptation n’est pas synonyme de fatalisme. (…) L’acceptation est un acte dynamique. Elle ne doit pas être synonyme d’inertie, de stagnation ou d’inactivité. Il faut simplement vérifier ce que la situation exige et mettre en œuvre ce que l’on pense être le mieux. Tant que l’on agit en accord avec le temps et que l’on est méticuleux, l’action est correcte ».
– Deng Ming-Dao, 365 Tao: Daily Meditations (trad. DeepL & ED)
Jeudi 25 avril
Je viens de finir l’épisode 5 de Gray Shelter : parce qu’elle n’a qu’une poignée d’épisodes, cette série gay coréenne est intense, mais aussi frustrante. Quand l’histoire est sur le point de devenir passionnante, voilà qu’elle se termine.
J’aurais voulu un épisode supplémentaire afin de permettre une meilleure évolution des personnages et de leurs sentiments. J’espérais une fin plus satisfaisante, tout en me doutant que je ne l’obtiendrais pas : l’ambition de cette série était de poser le cadre (un « gray shelter ») et de formuler des questions sans pour autant s’efforcer d’y répondre.
Ces deux âmes abimées par la vie peuvent-elles connaitre le bonheur après tant d’infortune ? Peut-être. Le reste est laissé à notre imagination.
Vendredi 26 avril
Je viens de relire les morning pages que j’ai rédigées il y a un mois pile. Impression de lire le journal d’un autre. C’est moi, mais ce n’est déjà plus moi. Tant de chemin parcouru !
Pourtant, au quotidien, je suis le même qu’hier, celui qui était le même que le jour d’avant, etc. Si on n’y prend garde, cette impression d’unité finit par masquer les mille révolutions qui nous bouleversent.
Notre mémoire n’est pas la gardienne du passé, mais la protectrice de notre identité : tout ce qui pourrait menacer l’intégrité du moi est savamment édité ou commodément oublié.
Samedi 27 avril
Hier, j’ai reçu ma nouvelle boite de thés « discovery ». Au mois de mars, c’était l’Asie. Ce mois-ci, c’est un voyage en Amérique du Sud : du thé blanc et du thé noir de La Cumbre (Colombie), ainsi que du thé vert et du thé noir de Registro, une ville située dans la région de São Paulo (Brésil).
Je n’ai gouté que le Bitaco Special White de Colombie pour le moment. La cueillette date de février 2024. C’est doux, fruité. Délicieux.
Pour reprendre les mots de Curious Tea : « Les grandes feuilles semi-oxydées produisent une liqueur fruitée aux saveurs équilibrées et à l’arrière-gout réconfortant. »
Dimanche 28 avril
Dans une édition de sa newsletter The Imperfectionist, Oliver Burkeman, l’auteur de Four Thousand Weeks (que je recommande), donne trois conseils d’écriture « qui ont eu un effet notable sur sa productivité d’écrivain » :
Good writing is pointing out – bien écrire, c’est montrer la direction à quelqu’un, lui indiquer ce qu’il doit remarquer, car c’est intéressant. Bien écrire, c’est ne pas perdre son lecteur dans les méandres d’une phrase obscure (coucou, les universitaires) ; ce n’est pas non plus le manipuler afin d’attiser sa colère (coucou, les journalistes).
Stopping is as crucial as starting – il faut s’arrêter d’écrire une fois qu’on a atteint l’objectif de sa session d’écriture, même si l’inspiration nous pousserait à continuer. Pourquoi ? Parce qu’en continuant, l’auteurice renforce ses pires impulsions. C’est seulement en arrêtant qu’iel cultive la patience, une vertu nécessaire à l’accomplissement de tout projet d’écriture. Des petites sessions d’écriture (1) nous rappellent que l’écriture est une activité modérément centrale à notre vie, ce qui diminue le risque de la trouver intimidante.
If you’re staring at a blank page, you’re doing it wrong – c’est là qu’entre en scène le jardin numérique. L’idée, c’est de créer un système où, plutôt que de se concentrer sur le projet final (un article de blog, une nouvelle, etc.), on rassemble ses idées et les développe, dans un effort continu et itératif. Ainsi, « la rédaction d’un article n’est que l’étape finale du processus, qui consiste à rassembler les différents points de vue, faits et citations que vous avez collectés et qui se sont fertilisés pendant des mois. » Le jardin numérique est parfait pour la non-fiction, mais peut aussi servir à l’écriture fictionnelle (cf. Lionel Davoust)
(1) Selon le Professeur Robert Boice (cf. How Writers Journey to Comfort and Fluency: A Psychological Adventure) :
« Pace yourself. Work in brief, regular sessions, 10-50 minutes in length, no more than 3-4 hours a day, 5 days a week. Use a timer to help yourself keep the sessions brief, and take breaks between each. »
Lundi 29 avril
Comme tout le monde, j’ai mes valeurs et mes idées politiques. Elles influencent ma manière de voir le monde et d’agir.
Cependant, en tant qu’écrivain, mon engagement s’arrête là où commence ma pratique artistique. Je ne nie pas que toute littérature est politique : elle l’est, qu’on le veuille ou non. Mais, en fiction, je considère que ce qui importe par-dessus tout, c’est l’histoire.
Chaque genre a ses codes, ses attentes et son imaginaire : je les accepte (avec plus ou moins de grâce). Même ceux de la romance, qu’on peut considérer comme un outil de propagande du patriarcat et de l’hétéronorme !
Mardi 30 avril
Ces dernières années, les réseaux sociaux se sont transformés en lieu de batailles rangées où l’on polémique sur le contenu des histoires mêmes, comme si elles étaient réelles. On juge que tel personnage est un « red flag », ou que la relation amoureuse n’est pas saine. On clame haut et fort que le roman n’aurait donc pas dû voir la lumière du jour. On conspue même l’auteurice comme s’iel avait commis un crime contre l’humanité.
Les débats, à l’origine sains et nuancés, se sont abâtardis. On a assisté à l’émergence d’une police de la pureté dans certaines communautés. Alors qu’on s’était débarrassé, bon an mal an, de la censure d’État, voilà qu’on la voit réapparaitre sous d’autres formes, plus démocratiques certes, mais tout aussi dangereuses. Pire encore : voyant les foules enragées sur les RS, beaucoup d’auteurices, voulant bien faire, se censurent.
N’oublions pas que beaucoup de ces écrivain·es-là font aussi partie de groupes minorisés. Plutôt que d'obtenir la liberté à laquelle iels avaient droit, iels se retrouvent à brider leur imaginaire et à le limiter à leur seule expérience.
Enough is enough.